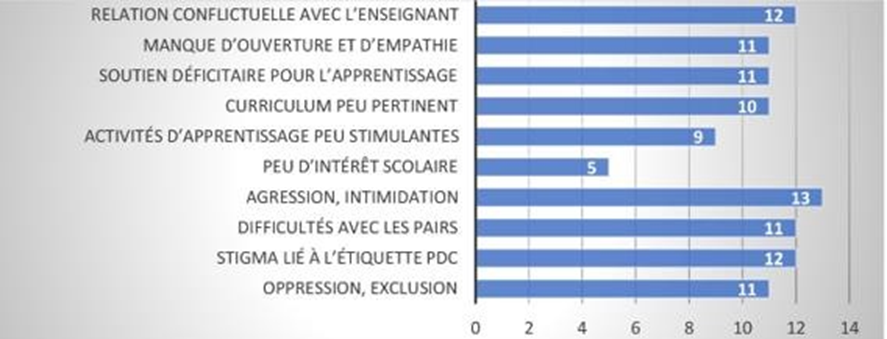-
Tribune libre #18 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ?

De quoi France Travail est-il le nom ?
Par André Decamp
Introduction
Le passage de Pôle emploi à France Travail ne se fonde pas uniquement sur le changement d’une entité administrative à une autre. Il augure une métamorphose structurelle du service public dédié à l’emploi en France. Et cela dans un contexte où les politiques publiques s’arriment de plus en plus aux logiques de responsabilisation, de contrôle et de performance. Cette tendance européenne largement documentée par Math (2009, p. 81-89), s’inscrit dans une évolution où les politiques d’activation prennent le pas sur les dispositifs assurantiels classiques.
L’objectif de cette réforme est une amélioration notable de la synchronisation entre les institutions, d’après Mouterde (2022), mais on y décèle une recentralisation dictatoriale dans le domaine de l’accompagnement.
Ainsi, cette réforme porte en elle une recomposition de la relation entre les institutions, les professionnels et les citoyens. Cette recomposition souligne des tensions importantes autour des questions de la justice sociale, de la dignité des personnes et du rôle éthique des conseillers de France Travail.
1. Une responsabilisation normative du chômage
Depuis la fin des années 1990, les politiques d’insertion ont insidieusement glissé vers des logiques nommées d’activation, dans le sens où le chômage est perçu moins comme un accident de parcours que comme une carence d’engagement. France Travail symbolise cette logique à travers l’injonction d’un contrat d’engagement réciproque » systématique, notamment pour les allocataires du RAS1. Cette responsabilisation redéfinit la protection sociale en un devoir de conformité à des trajectoires d’employabilité prédéfinies. Longo et al. (2020, p. 37-41) soulignent que les jeunes en difficulté intériorisent une forte culpabilité face à leur inactivité. D’autant que les dispositifs de contrôle de France Travail accentuent cette culpabilité. Ce qui prime ici ce n’est pas l’écoute en direction de la personne en recherche d’emploi mais l’application de dispositifs coercitifs.
2. Une rationalité instrumentale centrée sur la performance
La transformation initiée par France Travail s’inscrit dans une perspective de pilotage par une logique de résultat. Les indicateurs de suivi (nombre de rendez-vous taux de retour à l’emploi, contrôles réalisés) deviennent la norme d’évaluation de l’« accompagnement » des personnes en recherche d’emploi. Gillot (2022) dénonce cette « managérialisation du social » qui dénature les missions des conseillers et les soustrait de leur capacité d’examen éthique. Le rapport au temps est transformé : il ne s’agit plus d’accompagner, mais de produire des résultats. La rationalité prônait met en tension les pratiques professionnelles du travail social fondées sur la relation, l’adaptation et l’écoute. Ce constat est corroboré par le rapport IGAS2–IGF de septembre 2024, qui recommande de rééquilibrer les indicateurs quantitatifs avec une évaluation de la qualité des parcours d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi (Lara-Adelaïde et al, 2024, p. 6). Une structure d’assistance plus organisée autour de facteurs administratifs que d’une appréciation précise des réels besoins est mise en exergue par le rapport, d’où une imprécision en ce qui concerne le bien-fondé des accompagnements proposés (IGAS-IGF, 2024, p. 13). D’autant que, le Projet annuel de performance 20243, (ministère du Travail) fixe comme objectif prioritaire les retours rapides à l’emploi durable, renforçant une culture de l’efficacité chiffrée au détriment du suivi individualisé.
3. Une profession en tension : entre éthique du care et injonction à la conformité
Les conseillers de France Travail occupent une position ambivalente. Si l’on se fonde sur les travaux de Lipsky (1980), nous pourrions avancer que les conseillers sont pris dans un dilemme entre le respect des consignes hiérarchiques et leur responsabilité morale envers les usagers. Alvarez Rojas et al. (2021, p. 132-149) observent que les travailleurs sociaux, face à la pression croissante des logiques managériales, adaptent leurs modalités d’intervention pour préserver une dimension humaine dans l’accompagnement, malgré un cadre institutionnel prescriptif. En 2018, seul un tiers des bénéficiaires du RSA a reçu un accompagnement à visée professionnelle ou sociale. De plus, 76 % des CER4 signés ne comportent aucune action emploi, illustrant une déconnexion entre les outils de suivi et les réalités de terrain (Alvarez Rojas et al., 2024, p. 13). occupent une position ambivalente. Conformément à l’analyse de Lipsky (1980), ils sont pris dans un dilemme entre le respect des consignes hiérarchiques et leur responsabilité morale envers les usagers. Alvarez Rojas et al. (2021, p. 132-149) observent que les travailleurs sociaux, face à la pression croissante des logiques managériales, adaptent leurs modalités d’intervention pour préserver une dimension humaine dans l’accompagnement, malgré un cadre institutionnel prescriptif.
4. Le tournant algorithmique : déshumanisation du suivi
L’opulence croissante des outils numériques, en particulier pour la gestion des dossiers, est un des traits saillants de France Travail. D’après Le Monde (2024), les dispositifs numériques présélectionnent actuellement 60 % des contrôles. Le danger provoqué par le manque de transparence de ces instruments numériques, l’absence de justification quant aux choix effectués et les sources de discrimination potentielles qui en découlent sont signalés par La Quadrature du Net (2025). Effectivement, ces outils s’appuient sur des « scores de suspicion », déjà pratiqués par la CAF5. Selon Demazière, D. (2023) ? Le processus de décision est détaché de la relation humaine par ces outils automatisés, ce qui déstabilise l’expertise de terrain. L’accompagnement social est remanié en mécanisme de gestion de risques, par ce virage technologique, aux dépens de l’unicité de chaque situation humaine.
5. Des effets psychosociaux dévastateurs
La déshumanisation des circuits et l’augmentation des contrôles accentuent la précarité éprouvée par les publics ciblés. Un épuisement psychologique des individus assujettis à des obligations permanentes, sans être réellement accompagnés, est identifié par DREES (2020, p. 10-13). Selon Roch et Perret (2017, p. 207-213) les femmes isolées en état de pauvreté ressentent une culpabilisation continuelle dans le cadre de ces dispositifs. Le travail est alors perçu tel un parcours où se dressent des obstacles normatifs et un diktat sans perspective.
6. Vers une alternative : redonner du sens au travail social
Des projets comme les Territoires zéro chômeur proposent une méthode fondée sur la réintégration sociale par le biais de l’activité et la co-construction régionale, en réponse aux dissensions structurelles engendrées par France Travail. La mobilisation collective induite par l’emploi inclusif et la prise en compte des besoins territoriaux sont mis en valeur par ces expériences. Les recherches de Goller et al. (2021, p. 8-11) soulignent l’apport des outils numériques dans le cadre d’une éthique de la relation, uniquement s’ils sont co-élaborés avec les protagonistes ciblés, compréhensibles et font l’objet d’une régulation. Il est à d’actualité d’aller au-delà d’une discordance dichotomique entre refus et modernisation, en incluant les outils dans un dessein social caractérisé par les usagers en personne. Le non-partage des données entre les opérateurs et l’insuffisance de gouvernance uniformisée sont à l’origine d’une défaillance d’efficacité dans les processus de politique locale d’emploi, ainsi que des doublons et des dépenses inhérentes à cette organisation (Alvarez Rojas et al., 2024, p. 7). La DARES6 signale que, sous l’égide de ce programme, on dénombre plus de 3 290 personnes sans emploi recrutées par le biais d’un CDI, au sein des 83 territoires concernés par cette expérience. Cette opportunité dans le domaine de l’innovation sociale, générée cette approche, est corroborée par la Cour des comptes (2025) même si les dépenses inhérentes questionnent sur un élargissement prochain.
Conclusion
France Travail ne se caractérise pas uniquement par une réforme technico-administrative, il rassemble tous les éléments d’une métamorphose approfondie de l’action publique actuelle. À l’intersection des exigences de performance, de l’automatisation, des logiques de marché, il représente une restructuration des conditions assujetties au gouvernement des populations. Cette nouvelle composition questionne radicalement les bases du travail social, dépendant de la co-élaboration des parcours, la chronologie de la relation et de la légitimation des subjectivités.
Même s’ils ne peuvent être considérés comme des travailleurs sociaux, les conseillers de France Travail, pratiquent un métier hybride jonglant entre la gestion technico-administrative et l’accompagnement social (Lavitry, 2016 ; Revue Travail & Emploi, 2024). Se répartissant la charge du contrôle des allocataires du RSA, ils peuvent faire équipe avec des travailleurs sociaux, pour ce qui est l’accompagnement global (ministère des Solidarités, 2023). Cet aspect de l’organisation dévoile une distension éthique majeure : les ordres d’activation rapide sont fréquemment contradictoires avec le caractère complexe des trajectoires de précarité.
Cette distorsion entre nécessité d’écoute et logique gestionnaire induit chez les personnes accompagnées une perception d’impératif antinomique : s’engager sans pour autant être écoutées. Les conséquences sur le plan éthique sont lourdes : elles interrogent l’aptitude des conseillers à adapter leurs actions aux situations qui échappent à la norme, la position de la discrétion inhérente à l’accompagnement et le sens même de la relation professionnelle. Par conséquent, s’interroger sur « de quoi France Travail est-il le nom ? » est synonyme de questionner les configurations actuelles de gouvernementalité, et de protéger une éthique relationnelle de l’équité sociale, de l’écoute et du soin, face à l’algocratie croissante ; ceci réunit les conditions d’une métamorphose paradigmatique de l’action publique de notre époque. À la croisée des injonctions de performance, des outils numériques de gouvernement et des logiques de marché, il est le symbole d’un virage anthropologique dans la façon dont l’État managérial appréhende l’intérêt des personnes et le lien social. De ce fait, il interroge ouvertement les principes du travail social, qui sont fondés sur la chronologie de la relation, la prise en compte des subjectivités et l’affranchissement, par le biais de la co-construction.
Liste de références
- Alvarez Rojas, A. M., Rodríguez Llona, M., Mariale, L., & Mechaheb, D. (2021). Le travail social au prisme du pouvoir d’agir. Nouvelles pratiques sociales, 32(1), 132–149. https://www.erudit.org/fr/revues/nps/2021-v32-n1-nps06317/1080873ar/
- Cour des comptes. (2025). Les Territoires zéro chômeur : un modèle innovant à consolider. https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-zero-chomeur-un-projet-innovant-mais-couteux-selon-la-cour-des-comptes
- Demazière, D. (2023). Dire oui ou non à l’ordinateur. Retour sur la numérisation du service public de l’emploi. Que sait-on sur le travail ?
- DREES. (2020). Le travail social entre pouvoir et impuissance (n° 38), 10–13. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/Le%20travail%20social%20entre%20pouvoir%20et%20impuissance.pdf
- Gillot, X. (2022). Où va le travail social ? Contrôle, activation et émancipation. Calenda. https://calenda.org/719291
- Goller, D., Harrer, T., Lechner, M., & Wolff, J. (2021). Active labour market policies for the long-term unemployed: New evidence from causal machine learning. arXiv preprint, 8–11. https://arxiv.org/abs/2106.10141
- IGAS–IGF. (2024). Rapport sur la mission de coordination France Travail : enjeux, résultats et perspectives. Inspection générale des affaires sociales & Inspection générale des finances. https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-igas-igf-france-travail-2024.pdf
- INSEE. (2020). La crise sanitaire a fortement affecté l’emploi des jeunes. https://www.insee.fr/fr/statistiques/6012741
- La Quadrature du Net. (2025, juin 25). À France Travail, l’essor du contrôle algorithmique. https://www.laquadrature.net/2025/06/25/france-travail-essor-controle-algorithmique/
- Lavitry, L. (2016). Être conseiller à Pôle emploi : bricolage professionnel et identité au travail. Sociétés contemporaines, 104(4), 121–145. https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2016-4-page-121.htm
- Le Monde. (2024, avril 26). Des demandeurs d’emploi toujours plus contrôlés. https://www.lemonde.fr/emploi/article/2024/04/26/des-demandeurs-d-emploi-toujours-plus-controles_6230067_1698637.html
- Longo, M. E., Bidart, C., Alfonsi, J., Noël, M., & Berthet, T. (2020). Le rapport au travail des jeunes vulnérables. Revue des jeunes en situation de précarité, 5 (2), 37–41. https://www.erudit.org/fr/revues/rjs/2020-v5-n2-rjs06710/1085571ar.pdf
- Math, P. (2009). Workfare : l’activation des politiques sociales. Langage et société, 61, 81–89. https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2009-n61-lsp3489/038463ar.pdf
- ministère des Solidarités. (2023). Présentation de l’accompagnement global. https://solidarites.gouv.fr/sites/solidarite/files/2023-03/presentation_de_l_accompagnement_global.pdf
- ministère du Travail. (2023). Projet annuel de performance 2024 — Programme 102 : Accès et retour à l’emploi. https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/21339
- Mouterde, P. (2022, novembre). France Travail : entre réforme technique et pression politique. Le Monde diplomatique. https://www.monde-diplomatique.fr/2022/11/MOUTERDE/67309
- Revue Travail & Emploi. (2024). La transformation du métier de conseiller à l’emploi : entre normes institutionnelles et pratiques relationnelles. Travail & Emploi, 167(1), 31–54. https://www.cairn.info/revue-travail-et-emploi-2024-1-page-31.htm
- Roch, A., & Perret, D. (2017). Femmes pauvres et activation : entre assignation et résistances. Revue française de sociologie, 58(2), 207–213. https://www.erudit.org/fr/revues/rfs/2017-v58-n2-rfs582201/1043923ar.pdf
- Le Revenu de solidarité active (RSA), instauré en 2009, est un dispositif français combinant une allocation de revenu minimal avec un accompagnement social et professionnel. Il vise à lutter contre la pauvreté tout en imposant des obligations d’insertion, ce qui l’inscrit pleinement dans les logiques contemporaines d’activation (ministère des Solidarités, 2023). Selon Lemoine (2014), cette aide conditionnée renforce les dynamiques de contrôle en imposant des engagements souvent déconnectés des réalités vécues par les allocataires. Le RSA incarne ainsi une mutation de l’État social vers une forme d’intervention comportementale, où le traitement de la pauvreté repose moins sur des garanties structurelles que sur la mobilisation individuelle. En parallèle, la Cour des comptes (2022) rappelle que près de 30 % des personnes éligibles au RSA n’en font pas la demande, révélant les effets combinés de la stigmatisation, de la complexité administrative et de la peur des sanctions. Récupéré le 30 juin 2025 sur le site ↩︎
- Inspection générale interministérielle du secteur social, l’Igas réalise des missions de contrôle, d’audit, d’expertise et d’évaluation, conseille les pouvoirs publics et apporte son concours à la conception et à la conduite de réformes.
Elle intervient à la demande des ministres ou du Premier ministre, mais aussi sur la base de son programme d’activité. Elle traite de sujets mobilisant une part importante des ressources nationales et touchant à la vie de tous les citoyens : emploi, travail et formation professionnelle, santé publique, organisation des soins, cohésion sociale, Sécurité sociale, protection des populations. Récupéré le 30 juin 2025 sur le site https://www.igas.gouv.fr/nous-connaitre/qui-sommes-nous?%2F= ↩︎ - Récupéré le 30 juin 2025 sur le site https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/21339 ↩︎
- Le Contrat d’engagement réciproque (CER) est un document signé entre un bénéficiaire du RSA et l’organisme d’accompagnement (département ou France Travail), explicitant les engagements réciproques pour un parcours d’insertion. Selon une étude de la DREES (2021), 50 % des personnes orientées hors Pôle emploi disposaient d’un CER en 2019, et seulement 24 % intégraient une action claire de recherche d’emploi (p. 146). Ce CER formalise ainsi un outil à la fois d’accompagnement personnalisé et de contrôle institutionnel. Récupéré le 30 juin 2025 sur le site https://www.drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/Fiche-16-OARSA.pdf ↩︎
- En France, la branche Famille, connue également sous le nom des Allocations familiales, propose aux familles des aides sous forme de compléments de revenus, d’équipements, de suivis et de conseils, via le réseau des 101 caisses d’Allocations familiales (Caf), piloté par la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf). Récupéré le 30 juin 2025 sur le site https://caf.fr/professionnels/nous-connaitre/presentation ↩︎
- La Dares est un service statistique ministériel et fait partie de service statistique public (SSP). À ce titre, elle doit respecter un certain nombre de règles visant à maintenir la confiance dans les informations produites et diffusées, en particulier indépendance professionnelle, fiabilité, neutralité, qualité des processus, méthodologie solide, accessibilité. Les principales sont réunies dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne dont la dernière version date de novembre 2017. La Dares produit ses données en toute indépendance, sous le contrôle de l’Autorité de la statistique publique. Récupéré le 30 juin 2025 sur le site https://dares.travail-emploi.gouv.fr/qui-sommes-nous ↩︎
Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.
Pour citer cet article :
Tribune libre #18 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ? De quoi France Travail est-il le nom ? André Decamp. André Decamp, Regards sur le travail social, 8 juillet 2025. https://andredecamp.fr/2025/07/08/tribune-libre-18-comment-ecrire-leducation-populaire-en-2025/
-
Tribune libre #17 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ?

Articuler travail social et éducation populaire : entre pratiques d’émancipation et contraintes institutionnelles
Par André Decamp
Note d’ancrage géographique et temporel : Cette tribune s’inscrit principalement dans le contexte institutionnel français, tout en mobilisant des comparaisons internationales (notamment québécoises et latino-américaines) pour nourrir la réflexion critique. Elle prend pour toile de fond les réformes récentes du travail social en France (2022–2025), notamment les débats sur la refonte des diplômes et l’unification des formations sociales sous l’impulsion de la ministre Catherine Vautrin.
Voir article : https://www.lemediasocial.fr/reforme-des-diplomes-du-travail-social-catherine-vautrin-impose-une-concertation_waRV5wRésumé
L’articulation entre éducation populaire et travail social est l’objet de cette tribune, sous un angle critique. Les concordances et dissensions entre ces deux terrains d’action sont mises en exergue sous l’égide des dernières principales publications francophones (Jetté, Dartiguenave, Le Bossé, Rullac, etc.). Elle défend un remaniement politique et éthique des dynamiques sociales, sans confronter les militant.es et les professionnel.les. Les conditions institutionnelles visant à transmuter la praxis, les logiques néolibérales et les archétypes d’empowerment collectif y sont examinées, ainsi que les enracinements historiques semblables dans ces deux champs. Définir les fondements d’un commun social et éducatif basé sur l’émancipation collective, la légitimation des savoirs situés et la conflictualité démocratique est l’objectif de cette étude.
Introduction
Aspirant à consolider la capacité d’action des individus, à combattre les injustices et à contribuer à la transformation des relations sociales, l’éducation populaire et le travail social sont deux champs implantés dans les combats pour l’évolution de la société, d’un point de vue historique. Cependant, ces deux secteurs n’ont pas eu les mêmes cheminements et possèdent des moyens d’action fréquemment compartimentés, en dépit de leurs ressemblances idéologiques. Un décryptage analytique de cette articulation est proposé par cette tribune, en partant de programmes scientifiques primordiaux dans le domaine des sciences sociales, en particulier ceux de Jean-Yves Dartiguenave, Stéphane Rullac, Christian Jetté, Yves Le Bossé et d’autres experts.
Présenter de quelle manière un recoupement par le biais d’une nouvelle lecture de ces deux champs d’action contribue à bâtir des processus sociaux plus critiques, plus réflexifs et plus fondés sur un raisonnement d’émancipation est l’objectif que nous poursuivons. L’articulation entre l’éducation populaire et le travail social se révèle un réel projet politique de reconquête des connaissances et capacités d’action, éloigné d’un sommaire assemblage de postures professionnelles et d’expériences.
1. Une origine commune dans les luttes sociales
Les mouvements sociaux qui ont marqué le XIXe et le XXe siècle ont contribué à l’apparition de l’éducation populaire et du travail social, alors que la classe ouvrière se structurait afin de combattre la classe capitaliste et industrielle. Le propre de ces mouvements est leur manque d’homogénéité : les maisons du peuple, les cercles d’éducation, les mutuelles, la pédagogie libertaire, ainsi que le syndicalisme et un grand nombre de protagonistes, se sont efforcés de proposer des choix de substitution aux institutions majoritaires. Accroître une conscience de classe par le biais de la divulgation de savoirs critiques était le but de l’éducation populaire, dans sa mouture la plus politique, ainsi que l’évoquent les travaux de Richez (2011, p. 55-60).
De façon analogue, les formes initiales du travail social (patronages, œuvres religieuses ou laïques, assistances mutuelles) découlaient d’une réponse à un besoin urgent des habitants appauvris des cités, mais n’étaient pas sous l’égide de l’État, tout en réquisitionnant des structures d’organisation communautaire. À l’instar des luttes pour accéder à l’instruction ou des mouvements de jeunesse, ces pratiques ont quelquefois conflué. Cependant, ceci a été ralenti par des mécanismes de professionnalisation singularisés.
Jean-Yves Dartiguenave précise que ces deux secteurs « ont partie liée avec la volonté de transformer la société par le bas, à partir des savoirs profanes et des pratiques populaires » (2008, p. 96). Pour Christian Jetté (2008, p 98-101) l’histoire des OCASS du Québec est le fil conducteur d’un travail qui révèle par quels biais ces processus communautaires et critiques ont pu apparaître dans le cadre de mécanismes qui proposent, dans le même temps, la contestation et l’assistance. Ces évolutions ont contribué à l’apparition d’une culture de l’intervention collective qui va bien au-delà de la logique du service.
Le partage de ces épisodes historiques n’a pas été suffisant pour protéger une articulation vivante. Le travail social a été absorbé par des processus répondant aux normes de l’action publique, alors que l’éducation populaire a été intégrée à des politiques d’assistance à la vie associative. Afin d’appréhender la source des blocages contemporains et des capacités à relancer, une relecture de l’histoire est indispensable.
Les dynamiques communautaires, luttes ouvrières et rassemblements pour la justice sociale ont servi de toile de fond pour l’instauration de l’éducation populaire et du travail social. Selon Jean-Yves Dartiguenave ces deux champs « ont partie liée avec la volonté de transformer la société par le bas, à partir des savoirs profanes et des pratiques populaires » (2008, p. 96). Selon Christian Jetté, au sujet des OCASSS du Québec, leurs deux finalités sont de satisfaire les besoins sociaux, en conservant leur libre arbitre en ce qui concerne les logiques institutionnelles (2008, p 98-101).
Des rendez-vous manqués ont émaillé cette histoire commune, ainsi que l’a étayé Jean-Claude Richez (2011, p. 55-60) : les deux champs ont été séparés par le biais des institutions, en dépit leur contigüité solide : l’enracinement militant caractérise l’éducation populaire, tandis que la professionnalisation est le propre du travail social.
2. Travail social : entre professionnalisation et normalisation
Le travail social fait face à un mouvement double : le mouvement lié à sa standardisation par le biais des méthodes de management et de néolibéralisme d’une part et celui de sa professionnalisation, d’autre part.. La menace d’une dépolitisation des pratiques professionnelles plane, conséquence des appels à projet, indicateurs et protocoles, selon Stéphane Rullac (2014, p. 121).
Ce constat est validé par Pierre Savignat (2009), qui envisage un repositionnement politique du travail social dans un contexte de réformes néolibérales, mais sans trahir ses objectifs historiques. Bernard Bouquet (2006, p. 127-130) complète cette analyse par le constat d’une tension de la fonction de management, acculée à coordonner éthique sociale et efficacité gestionnaire.
Le changement du langage inhérent aux politiques sociales caractérise cette dynamique. L’augmentation de l’utilisation de mots tels que « autonomie », « activation » et « parcours » éclipse une individualisation des problématiques sociales, qui contribue à tenir les individus pour responsables de l’exclusion. Ces concepts, incorporés dans le travail social par le biais des référentiels de l’action publique, diminuent l’alternative d’une lecture structurelle des injustices.
3. Tensions et critiques dans l’articulation entre éducation populaire et travail social
L’analyse de l’articulation entre éducation populaire et travail social ne serait pas complète sans un examen critique des deux domaines et des tensions potentielles qui peuvent émerger de leur rapprochement.
3.1. Critique de l’éducation populaire
Bien que l’éducation populaire soit souvent présentée comme un vecteur d’émancipation, elle n’est pas exempte de critiques. Comme le souligne Nicourd, l’émergence de logiques de contractualisation et de professionnalisation dans le champ de l’éducation populaire tend à édulcorer sa dimension critique structurelle. Cette évolution peut mener à une forme d’institutionnalisation qui risque de compromettre l’essence même de l’éducation populaire, à savoir sa capacité à remettre en question les structures sociales existantes.
3.2. Conflits potentiels dans l’articulation
L’articulation entre éducation populaire et travail social, bien que souhaitable, peut générer des tensions significatives :
- Professionnalisation vs militantisme : Le travail social, caractérisé par sa professionnalisation, peut entrer en conflit avec l’enracinement militant de l’éducation populaire. Cette divergence peut créer des frictions dans les approches et les méthodes d’intervention.
- Contraintes institutionnelles : Le travail social, soumis à des normes et des protocoles stricts, peut se heurter à la flexibilité et à l’autonomie revendiquées par l’éducation populaire. Les appels à projet, indicateurs et protocoles imposés au travail social peuvent être perçus comme incompatibles avec les principes de l’éducation populaire.
- Langage et conceptualisation : L’utilisation croissante de termes comme « autonomie », « activation » et « parcours » dans le travail social peut entrer en contradiction avec le vocabulaire et les concepts de l’éducation populaire, créant des malentendus ou des désaccords sur les objectifs et les méthodes.
- Rapport aux savoirs : Bien que le texte propose une coproduction des évaluations basée sur des pratiques, la mise en œuvre de cette approche peut générer des tensions entre les savoirs académiques valorisés dans le travail social et les savoirs expérientiels privilégiés par l’éducation populaire.
- Cadres institutionnels : La reconnaissance politique des alternatives d’organisation et de savoirs, ainsi que les méthodes de financement, peuvent créer des conflits entre les acteurs du travail social et ceux de l’éducation populaire. Les contraintes institutionnelles peuvent être perçues comme un frein à l’innovation et à l’expérimentation.
3.3. Vers une articulation consciente des défis
Pour surmonter ces tensions, il est nécessaire de repenser les pratiques sociales critiques à partir d’une éthique située de l’émancipation. Cela implique de reconnaître les forces et les faiblesses de chaque domaine, d’anticiper les conflits potentiels et de travailler activement à leur résolution.
L’objectif d’un « commun politique » entre l’éducation populaire et le travail social ne peut être atteint qu’en abordant ouvertement ces défis. Cela nécessite un dialogue constant, une remise en question mutuelle et une volonté de dépasser les clivages institutionnels et conceptuels pour créer une praxis véritablement transformatrice.
4. Résistance et réinvention : les pratiques professionnelles face aux pressions institutionnelles
Néanmoins, une multitude de pratiques professionnelles résistent face à cette pression. Un écho à la notion de « bricolage » mise au point par Certeau (1990) trouve ici sa place : pour ne pas trahir leur éthique de l’intervention, les professionnels font preuve d’adaptation et reconfigurant ou détournant les injonctions institutionnelles. L’objectif est d’investir les marges, afin de conserver une zone de dignité, d’inventivité et de négociation et non pas de transgresser.
C’est la souvenance des luttes sociales qui entretient cette aptitude à la résistance : la pratique ne peut être dissociée d’un engagement éthique, et même politique, pour la plupart des travailleurs sociaux. Les formations à la critique institutionnelle, les collectifs d’analyse de pratiques ou les groupes de soutien entre condisciples, forment des espaces de premier plan pour que perdure cette valeur réflexive de la profession.
Des lignes de fracture sont indissociables du travail social et, en cela, on peut constater qu’il n’est pas un domaine uniforme. Les professionnel.les de ce secteur se situent au croisement de pressions structurelles, entre intention de transformation et logique d’adaptation. Reconsidérer cette situation, c’est admettre que le travail social peut reprendre une configuration d’intervention politique sur le terrain, plutôt que d’être limité à une pratique d’ajustement.
5. Éducation populaire : praxis critique et transformation sociale
L’éducation populaire demeure un vecteur idéal de transformation sociale, transpercée par des dissonances entre radicalité et institutionnalisation, lorsqu’elle se fonde sur des rapports de pouvoir et des réalités authentiques : en cela, elle est, en même temps, une pratique sociale ancestrale et formellement moderne. Ainsi que le pointent Besse, Chateigner et Ihaddadene (2016) on peut la définir de façon plurielle, controversée, imprégnée par une pression permanente entre cadre normatif et projet d’émancipation. Elle se manifeste dans un juste milieu précaire, assimilée dans des politiques publiques locales, tout en étant chargée de ruptures méthodologiques et symboliques.
Selon Stéphane Rullac (2018), elle symbolise une sphère d’intelligence collective critique, au sein de laquelle le développement du savoir ne peut être séparé de l’analyse du pouvoir et ne peut donc être limitée à une méthode pédagogique. Il est question d’un mécanisme de politisation des acteurs, sous l’égide de ces derniers. Cette position se situe dans la lignée des travaux de Paulo Freire, qui considère que l’éducation est constamment politique, enracinée dans une praxis transformatrice : « L’éducation véritable est praxis, réflexion et action de l’homme sur le monde pour le transformer » (Freire, 1970, p. 33–34).
L’éducation populaire favorise l’analyse collective, le débat et la co-construction, conception éloignée des démarches descendantes de transmission. La conférence gesticulée, l’arpentage ou l’entraînement mental représentent des dispositifs qui reflètent ce désir de voir apparaître des savoirs situés critiques, aptes à produire une émancipation réelle. Ces méthodes questionnent à nouveau les relations entre savoirs émanant de l’expérience et savoirs légitimes et mettent en valeur l’analyse partagée des processus d’oppression.
Cette intention critique bute actuellement contre les logiques de commande publique, les appels à projets concurrentiels et les desiderata de rentabilité, ainsi que le soulignent les travaux de Nicourd (2009) sur les méthodes d’organisation du travail associatif. Face à ces sujétions, les structures se retrouvent contraintes d’atténuer leur posture politique, afin de bénéficier de financements, en prenant le risque d’être privées de leur capacité critique.
Reconsidérer l’articulation entre les autres secteurs militants et professionnels et l’éducation populaire est indispensable pour outrepasser cette tension. Cette évolution est mise en lumière par plusieurs mouvements survenus récemment : les expérimentations pédagogiques au sein des centres sociaux ou la reconquête de l’éducation populaire par des collectifs d’usager.ères, ainsi que des mouvements antiracistes ou féministes, en sont des exemples. Ces démarches ont pour objectif de rassembler les structures sociales avec les vécus personnels, à assurer la création d’espaces d’élaboration d’un pouvoir d’agir collectif et à politiser les enjeux du quotidien.
Pour ces raisons, l’éducation populaire représente une démarche transversale, apte à imprégner les dynamiques de mobilisation citoyenne et les pratiques du travail social, et non pas un champ séparé des autres. Elle joue le rôle d’un levier incontournable afin d’appréhender l’intervention sociale en tant qu’acte politique partagé.
6. Convergences critiques : vers des alliances stratégiques
Des méthodes critiques hybrides se font jour au croisement de l’éducation populaire et du travail social, annonciatrices de transformation. Selon Rullac (2015) ces « bifurcations démocratiques » sont représentées au sein d’alliances associatives, d’expériences locales et de projets collectifs. Ces espaces de carrefours contribuent à l’avènement d’autres configurations d’action, émanant de savoirs pluriels et de pratiques situées.
Dans cet objectif, les ateliers d’analyse, les coopératives éducatives, les régies de quartier et les centres sociaux sont des exemples concrets de ces articulations prolifiques, en composant une analyse sociale issue de la vie quotidienne, en mettant en délibéré les enjeux du pouvoir et en rassemblant des pédagogies coopératives.
Yves le Bossé (2012, 2014) suggère l’exemple du « développement du pouvoir d’agir », tel un point de liaison entre éducation à la citoyenneté critique et accompagnement social. Par le biais de cette démarche, les travailleurs sociaux jouent un rôle de co-acteurs de transformation auprès des personnes accompagnées, ce qui suppose un déplacement de posture : se retirer de la logique de l’expert pour s’engager dans une logique d’animation des capacités critiques.
Cette reconversion implique de réexaminer le sens du rôle de l’intervenant : il devient un animateur de dynamiques collectives et n’est plus uniquement un gestionnaire de parcours, ce qui trouve écho dans les observations de Stéphane Rullac sur la dimension d’une éthique située, enrichie par les récits de vie et les savoirs d’usage (Rullac, 2011).
Ainsi que le démontrent Jaeger (2019) et Jetté (2008), l’articulation entre économie sociale et solidaire (ESS), travail social et éducation populaire est la source de débouchés encourageants. Lorsqu’elles sont épaulées par des préceptes de coopération, de délibération et d’autogestion, les pratiques associatives se transforment en instruments de recomposition des liens sociaux et d’émancipation.
Pour échapper aux impacts de dilution politique ou aux récupérations institutionnelles, ces confluences nécessitent d’être bâties autour de stratégies. Elles requièrent la création d’instances de coordination démocratique, la formalisation des cadres de partenariat critique et de concevoir l’évaluation tel un mécanisme collectif de relecture de la signification de l’action, et non uniquement d’être appréhendées en termes d’indicateurs.
7. L’épreuve des institutions : entre compromis et conflits
Qu’elles émanent du secteur culturel, médico-social ou éducatif, les institutions publiques forment fréquemment un espace contradictoire pour l’articulation entre éducation populaire et travail social. Dans le même temps, elles proposent une reconnaissance professionnelle et des moyens d’action, mais elles véhiculent les normes qu’elles imposent. Stéphane Rullac (2011, p. 125) détermine pour ce sujet une « professionnalisation réflexive », apte à réunir volontés de subversion et exigences d’adaptation.
Un dilemme s’offre aux professionnels enrôlés dans cette articulation : jusqu’à quel stade peuvent-ils collaborer avec les institutions sans renier une optique critique ? Emmanuel de Lescure et Francis Lebon (2016) précisent que l’incursion dans des logiques de prestation ou de projet aboutit quelquefois à la dilution de l’intention politique initiale. Il est alors indispensable de conserver une préoccupation éthique, en particulier en entretenant des lieux de contre-pouvoirs internes, d’analyse collective et d’autoformation.
Toutefois, ce rapport circonspect aux institutions est grandement dépendant des marges de manœuvre qui s’offrent aux collectifs engagés, aux alliances locales et aux rapports de force, en cela il n’est pas stéréotypé. L’observation des OCASSS au Québec étudiée par Jetté (2008) confirme que des formats participatifs, critiques et hybrides sont susceptibles de s’institutionnaliser, sans pour autant être dépossédés de leur dimension politique, mais seulement s’ils préservent la gouvernance partagée, la redevabilité communautaire et les principes d’autogestion.
L’objectif est davantage d’interpeller les institutions et d’y inclure une conflictualité démocratique, plutôt que de les repousser. Cette expectative est indissociable d’une aptitude d’analyse systémique des rapports de domination et d’outils pour résister à l’instrumentalisation. De ce point de vue, les démarches en clinique du travail social et en analyse institutionnelle constituent des atouts inestimables afin de transmuter les espaces d’intervention en lieux de contestation équitable et de réflexion.
8. Pédagogies populaires et savoirs situés : un socle pour la transformation
La question du savoir se trouve au centre de cette articulation : qui génère le savoir sur l’action sociale ? Quelles sont les conditions de sa transformation, de son appropriation ou de son partage ? Engendrée par les théories de Freire, la tradition de l’éducation populaire met en valeur la reconnaissance des savoirs expérientiels, la co-construction des savoirs et la pédagogie du questionnement.
L’approche choisie par Yves Le Bossé se porte vers un accompagnement social via un raisonnement d’empowerment partagé, par le biais des mécanismes de formation fondés sur l’expérience des individus accompagnés, en contradiction avec une logique descendante de l’intervention et du savoir. Dans cette optique, les communautés apprenantes, les lieux de formation hybride (chercheurs, intervenants, citoyens) et les méthodes de recherche-action se transforment en espaces stratégiques.
9. Pour une praxis transformatrice : conditions et leviers
L’articulation entre éducation populaire et travail social ne peut être dictée, elle est indissociable des conditions épistémiques, organisationnelles et politiques. En premier lieu, il convient d’assurer l’indépendance des protagonistes associatifs, ainsi qu’une multitude de travaux autour de l’instrumentalisation du monde associatif (Nicourd, 2009, p. 65) l’ont évoqué. Par la suite, il convient d’appréhender les articulations dans la durée, en tenant compte d’une chronologie adaptée aux mécanismes d’émancipation.
Le soutien à la recherche-action critique (Rullac, 2014, p. 120), la légitimation des pratiques collectives, telles des démarches d’intervention à part entière (Le Bossé, 2014, p. 22-25) et la mise en réseau des protagonistes de terrain impliqués dans des expériences, font partie des leviers reconnus. En l’occurrence, l’objectif est d’organiser un « commun politique » de l’éducation populaire et du travail social, qui aboutisse à une édification collective de finalités partagées et qui ne soit pas uniquement une alliance d’opportunité.
Cette praxis innovatrice est aussi basée sur une reformulation du rapport aux savoirs : la co-production des évaluations en se basant sur des pratiques devient la norme, au lieu de la transmission verticale des connaissances. Les lieux de formation croisée (militant.es, habitant.es, professionnel.les) favorisent ce mouvement critique, en stimulant une mémoire des combats menés, une créativité sociale et une intelligence collective. Rullac (2018, p. 117) suggère de « repens[er] les pratiques sociales critiques à partir d’une éthique située de l’émancipation ».
Cette évolution dépend, cependant, de la configuration des cadres institutionnels et est également dépendante de la reconnaissance politique des alternatives d’organisation et de savoirs, des méthodes de financement durables et souples et des politiques publiques bénéfiques aux expérimentations locales. Cette contrainte peut être assimilée à un acte de résistance, dans un environnement de rationalisation néolibérale.
Finalement, il est indispensable d’appréhender les articulations internationales. Les exemples latino-américains (inspirés de Freire), québécois (Jetté, 2008) ou des mouvements féministes radicaux révèlent qu’une multiplicité de modèles est possible et que les mettre en parallèle contribue à agrandir nos imaginaires politiques et professionnels. Une praxis transformatrice est indissociable d’une solidarité critique entre mouvements, territoires, expériences et ne peut se concevoir dans un cadre national restreint.
10. Conclusion
Comme le souligne Nicourd (2009, p. 65), l’émergence de logiques de contractualisation et de professionnalisation dans le champ de l’éducation populaire tend à édulcorer sa dimension critique structurelle. Par ailleurs, Lamoureux (2010, p. 223), dans son analyse des arts communautaires, alerte sur le fait que : « peu de projets parviennent à créer un lieu véritable de délibération politique […] la pluralité des voix et des différences est trop souvent oubliée ». Ces deux points de vue nous invitent à conclure que toute réforme ambitieuse doit viser la reconfiguration institutionnelle des cadres de l’intervention, et pas seulement une adaptation des outils pédagogiques ou méthodologiques.
Reconstruire l’articulation entre éducation populaire et travail social c’est tout d’abord repousser les divisions historiques entre les pratiques militantes et professionnelles, admettre que la mutation sociale est indissociable d’une lucidité politique autour des tensions inhérentes à nos institutions, de savoirs situés et de formes d’intervention collectives.
L’objectif est d’élaborer un projet de société basé sur l’émancipation collective et non de se contenter d’une entente tactique. Ainsi que le met en exergue Stéphane Rullac (2010, p. 115), « le contre-pouvoir instituant est une ressource démocratique qui ne peut se déployer sans reconnaissance des marges d’expérimentation sociale et pédagogique ». Cette articulation représente un levier de premier plan pour métamorphoser la pratique sociale dans un cadre critique et non un simple supplément éthique.
En dépit de son angle critique, cette tribune ne se targue pas d’une neutralité absolue : elle participe à une intention assumée de transformation sociale, tout en admettant les tensions, limitations et dissonances de l’articulation présentée.
10. Ouvertures : perspectives de recherche, formation et engagement collectif
Controverses et tensions : regards critiques sur l’articulation
Certains auteurs mettent en garde contre les usages technocratiques de l’éducation populaire dans les politiques de cohésion sociale. Selon Denis Castra (2018), la « participation » peut devenir un mot d’ordre dépolitisé, mobilisé pour faciliter l’acceptation de dispositifs. D’autres, comme Diane Lamoureux, alertent sur les risques d’invisibilisation des dominations internes aux groupes d’éducation populaire eux-mêmes. Ces critiques invitent à une posture réflexive constante.
L’enjeu de l’articulation entre travail social et éducation populaire dépasse largement la pratique professionnelle : il concerne aussi la manière dont nous formons les futurs praticiens, engageons les institutions éducatives, et pensons la recherche en sciences sociales. Dans ce sens, trois voies complémentaires méritent d’être explorées.
10.1 Vers une recherche partenariale et située
La recherche en travail social et en éducation populaire gagne en légitimité lorsqu’elle prend appui sur les pratiques réelles, en s’appuyant sur des méthodologies telles que la recherche-action, la recherche collaborative ou les récits de vie. Ces démarches permettent de faire dialoguer des savoirs différents, et d’ancrer les résultats dans les besoins du terrain. Le modèle de la recherche participative tel que le décrit Le Bossé (2014) offre ici une matrice robuste pour dépasser la séparation entre chercheurs et praticiens.
10.2 Repenser la formation des professionnels
L’universitarisation des formations sociales et éducatives a parfois contribué à une scission entre théorie et pratique, voire entre militantisme et professionnalisation. Pour retrouver une cohérence formative, il convient de réintroduire l’histoire des luttes sociales, les méthodes d’éducation critique, ainsi que l’analyse institutionnelle dans les cursus. Ces éléments permettraient d’outiller les futurs professionnels pour comprendre les tensions de leur métier et pour agir de manière située.
10.3 Construire des alliances politiques durables
Concrètement, cela suppose de créer des espaces inter-institutionnels d’expérimentation collective (comités de liaison entre structures sociales et éducatives), de formaliser des chartes éthiques de coopération, et de développer des formations communes. Des exemples inspirants existent : collectifs interquartiers, universités populaires autogérées, ou centres sociaux en gouvernance partagée. Il s’agit aussi de favoriser l’accès à un financement coopératif et mutualisé, moins dépendant des logiques d’appels à projets concurrentiels. Enfin, cette articulation appelle à repenser les formes d’engagement collectif. Cela suppose d’instaurer des espaces permanents de dialogue entre acteurs du social, de l’éducatif, de la recherche, du syndicalisme et des mouvements sociaux. Ces alliances, pour être effectives, doivent se structurer à partir d’une analyse partagée des rapports de pouvoir et des inégalités structurelles.
11. Synthèse des concepts clés
Note d’accessibilité : Pour faciliter la lecture aux praticien·nes, étudiants ou acteurs associatifs non spécialisés, ce lexique définit les notions clés utilisées dans la tribune.
- Éducation populaire : Démarche éducative visant l’émancipation des individus à partir de leurs savoirs et expériences.
- Travail social : Ensemble d’interventions professionnelles orientées vers l’aide, la médiation et la transformation des conditions sociales.
- Pouvoir d’agir (empowerment) : Capacité d’un individu ou d’un groupe à transformer sa situation par une action autonome.
- Recherche-action : Dispositif méthodologique visant à produire des savoirs en lien direct avec la transformation des pratiques sociales.
- Professionnalisation réflexive : Modèle de professionnalité qui articule normes de métier, éthique, et posture critique.
- Institutionnalisation : Processus par lequel une pratique militante ou communautaire est absorbée ou encadrée par une structure officielle, souvent au risque de sa dépolitisation.
- Commun politique : Notion désignant un espace partagé de lutte, de pensée critique et d’élaboration de nouveaux modèles d’action sociale.
12. Glossaire explicatif
- Institutionnalisation : processus par lequel une pratique sociale autonome est intégrée et parfois neutralisée par une structure officielle. Exemple : l’intégration des formations d’éducation populaire dans le système universitaire.
- Savoirs situés : savoirs issus de l’expérience vécue, produits par les personnes elles-mêmes dans leur contexte, en opposition au savoir théorique désincarné.
- Empowerment/pouvoir d’agir : capacité d’un individu ou d’un groupe à analyser sa situation et à agir collectivement pour la transformer.
- Praxis : articulation entre la théorie et l’action, qui vise la transformation sociale consciente. Terme central dans la pensée de Paulo Freire.
- Contre-pouvoir instituant : dynamique par laquelle des collectifs produisent du changement social depuis la marge ou contre l’institution dominante (Rullac, 2020).
Liste des références
- Besse, L., Chateigner, F., & Ihaddadene, F. (2016). L’éducation populaire. Savoirs, 42, 11–26.
https://doi.org/10.3917/SAVO.042.0011 - Bouquet, B. (2006). Management et travail social. Revue française de gestion, 168–169, 125–142.
https://doi.org/10.3166/RFG.168-169.125-142 - Castra, D. (2018). Participation et gouvernance : un nouveau régime d’action publique ? Vie sociale, (23), 105–118.
- Dartiguenave, J.-Y. (2008). Éducation populaire et intervention sociale : des logiques d’action à réinventer ? Éducation et Sociétés, 22, 91–108.
- Dartiguenave, J.-Y. (2010). Pour une sociologie du travail social. Rennes : Presses de l’EHESP.
- Jaeger, M. (2019). L’ESS et le travail social : les nouvelles convergences entre deux conceptions de la solidarité. Vie sociale, 1, 219–230. https://doi.org/10.3917/vsoc.193.0219
- Jetté, C. (2008). Les organismes communautaires et la transformation de l’État-providence. Québec : Presses de l’Université du Québec.
- Lamoureux, D. (2010). Les arts communautaires : des pratiques de résistance artistique interpellées par la souffrance sociale. Amnis, (9), 211–229. https://doi.org/10.4000/amnis.1142
- Lebon, F., & de Lescure, E. (2016). L’éducation populaire au tournant du XXIe siècle. Savoirs, 4.
- Le Bossé, Y. (2012). Le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités : un modèle pour l’intervention. Service social, 58(1), 9–26.
- Le Bossé, Y. (2014). Pratiques collectives et intervention : repères pour une contribution du travail social au développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités. Québec : Presses de l’Université Laval.
- Nicourd, S. (2009). Éducation populaire : organisation du travail associatif et action publique. Éducation et formations, 56, 62–73. https://doi.org/10.3917/EH.056.0062
- Richez, J.-C. (2011). L’éducation populaire à l’épreuve du service social : les rendez-vous manqués (1930–1950). Agora débats/jeunesses, 58, 55–69. https://doi.org/10.3917/agora.058.0055
- Rullac, S. (2011). Une professionnalisation réflexive : vers une éthique des savoirs situés. Pensée plurielle, 28, 119–130.
- Rullac, S. (2014). La recherche-action en travail social : entre expérimentation et critique instituante. Vie sociale, 8, 117–129.
- Rullac, S. (2015). L’expérimentation sociale : une bifurcation démocratique ? Pratiques, 65, 112–122.
- Rullac, S. (2018). Émancipation et intelligence collective : repenser les pratiques sociales critiques. Politiques et interventions sociales, 22, 115–128.
- Rullac, S. (2020). Le contre-pouvoir instituant comme levier d’innovation sociale. Pensée plurielle, 47, 110–120.
- Savignat, P. (2009). Le travail social aux défis du néolibéralisme : Entre le et la politique. Le Sociographe, 30, 21–30. https://doi.org/10.3917/GRAPH.030.0021
Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.
Pour citer cet article :
Tribune libre #17 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ? Articuler travail social et éducation populaire : entre pratiques d’émancipation et contraintes institutionnelles, André Decamp. André Decamp, Regards sur le travail social, 3 juillet 2025. https://andredecamp.fr/2025/07/03/tribune-libre-17-comment-ecrire-leducation-populaire-en-2025/
-
Tribune libre #16 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ?
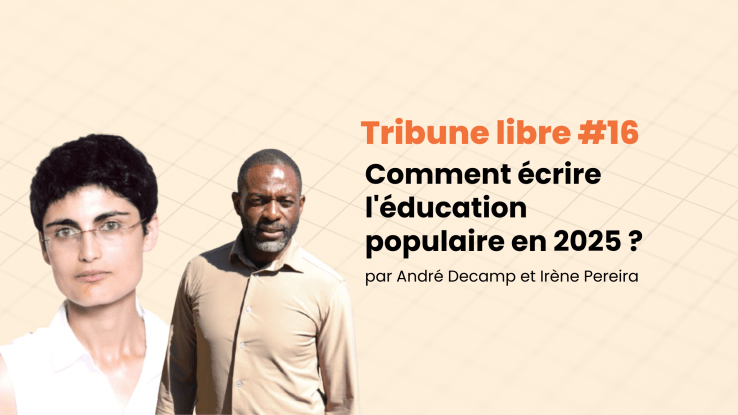
Discussion entre André Decamp et Irène Pereira sur l’éducation radicale
Suite à la publication de l’article « De l’éducation radicale à l’éducation populaire radicale », André Decamp1 a bien voulu réagir à cet article.
André Decamp : La contribution d’Irène Pereira « De l’éducation radicale à l’éducation populaire radicale » (Pereira, I., 2025) représente un apport théorique fondamental, dans le cadre d’un recentrage constant des conduites éducatives critiques. Cet article m’a particulièrement interpellé dans le cadre de mes réflexions sur les pratiques d’éducation populaire politique. Dans la mesure où il met en avant les fondements idéologiques et politiques de l’éducation populaire, tout en ouvrant des perspectives très intéressantes pour repenser ses formes actuelles. En effet, en explorant les tensions et les croisements possibles entre éducation populaire et éducation radicale, l’autrice propose une distinction conceptuelle nette entre ces deux approches, ce qui m’a conduit à questionner plusieurs idées que je tenais pour acquises.
En dépit de la volonté d’une élaboration commune des savoirs, l’éducation populaire politique, inspirée de la conception nouvelle envisagée par Paulo Freire, demeure imprégnée par une discordance entre le « peuple » et les éducateurs. Cette tension, que j’ai pu constater moi-même dans certaines dynamiques associatives ou militantes, m’interpelle par sa persistance : elle montre combien les intentions égalitaristes peuvent être contrariées par des logiques structurelles.
En revanche, la conception de l’éducation radicale est conçue comme équivalente à un apprentissage autodidacte horizontal et collectif provenant d’une frange active minoritaire.
L’objectif dominant de cet article — par quel biais concilier les contributions de la formation autodidacte radicale et une éducation populaire critique, en évitant la paralysie politique ou l’infiltration institutionnelle — se situe dans ce contexte tendu.
L’auteure utilise des dispositifs d’analyse dialectique et conceptuelle (Reboul, 1983) et choisit l’angle de la philosophie sociale (Fischbach, 2009) pour apporter une réponse à ce questionnement. Ce choix d’approche, à la fois rigoureux et engagé, m’a semblé fécond : il permet de dépasser la simple opposition idéologique pour penser une articulation dynamique entre marges et institutions.1. De la conscientisation à l’action directe
S’appuyant sur Paulo Freire, Irène Pereira montre que même les démarches co-constructives de l’éducation populaire restent prises dans une hiérarchie implicite entre éducateurs et éduqués. Chez Freire (1970/2021), l’éducateur-élève rencontre l’élève-éducateur, mais la relation est toujours structurée par une position sociologique différenciée : l’éducateur reste un professionnel, souvent de classe moyenne, formé à l’université.
« Il faut que l’éducateur et le politique soient capables de connaître les conditions structurelles dans lesquelles la pensée et le langage du peuple se constituent dialectiquement » (Freire cité par Pereira, I., 2025).
Cette co-construction, bien qu’égalitariste en intention, n’évacue pas la dissymétrie. L’éducation radicale, telle que définie par Pereira, dépasse ce modèle en mettant l’accent sur l’autoformation horizontale entre pairs, par des groupes minoritaires engagés dans des luttes concrètes (Charpenel, 2016 ; Pineau, 2019). Ce point me semble à la fois juste et radical : il pousse à reconsidérer nos pratiques éducatives hors de tout cadre formel. Cependant, je me demande si cette horizontalité pure est réellement praticable à large échelle, ou si elle ne risque pas de rester cantonnée à des groupes très politisés, déjà autonomes.
2. Du peuple aux minorités agissantes
L’éducation populaire, même dans sa forme politique, travaille souvent avec la catégorie de « peuple », conçue parfois comme une entité homogène. Pereira introduit une rupture importante en la remplaçant par la notion de minorités actives (Moscovici, 1979/1996), définies non par le nombre, mais par leur capacité à influencer le social à travers des pratiques d’organisation autonome.
« Les minorités qui sont — et ont toujours été — l’élément de progrès peuvent s’y épanouir sans entraves, et, par leur effort de propagande, y accomplir l’œuvre de coordination qui précède l’action » (Pouget cité par Pereira, I., 2025)
Cette conception me paraît pertinente : elle met en lumière des dynamiques souvent invisibilisées dans les discours éducatifs dominants. Elle rejoint également mon propre intérêt pour les formes de mobilisation à la marge, qui constituent souvent les foyers d’innovation sociale. Toutefois, cette lecture appelle aussi à une vigilance : une insistance exclusive sur les minorités agissantes peut écarter les enjeux de massification ou de médiation des savoirs.
3. De l’institutionnalisation à l’autonomie conflictuelle
L’un des apports les plus importants de l’article est sa critique des tentatives d’institutionnalisation de l’éducation populaire politique. Pereira démontre que les savoirs issus de l’éducation radicale sont souvent captés, dépolitisés ou marginalisés dans les cadres professionnels (Pignedoli & Faddoul, 2019).
« La conscientisation émanait d’une population de jeunes femmes plutôt homogène, enthousiaste et tournée vers le collectif […]. L’enseignement supérieur met à contribution une population hétérogène, souvent passive […] » (Fischer cité par Pereira, I., 2025)
Ayant moi-même observé les effets de la professionnalisation sur certaines pratiques militantes, je me reconnais dans cette analyse. L’équilibre entre reconnaissance institutionnelle et autonomie critique est délicat. J’adhère à l’idée d’une « autonomie conflictuelle » comme posture, mais elle suppose une lucidité politique constante, difficile à maintenir sans soutien collectif.
4. Vers une éthique de l’engagement éducatif
L’analyse de Pereira interpelle éthiquement les professionnel·les de l’éducation populaire. Leur engagement ne peut se limiter à un rôle professionnel neutre ou gestionnaire : sans ancrage militant dans des collectifs autonomes, ils risquent de reproduire des dynamiques verticales sous couvert de co-construction.
Cette critique me semble salutaire. Elle invite à une introspection sincère : dans quelle mesure notre posture éducative s’aligne-t-elle sur nos principes politiques ? En tant qu’éducateur·rice, il devient essentiel d’interroger le lien entre notre position professionnelle et notre implication dans des espaces de lutte, sans quoi l’éducation critique risque de se vider de son contenu.
5. Une redéfinition du champ éducatif critique
L’article aboutit à une architecture tripartite du champ éducatif radical :
– Autoformation radicale : processus informels de co-apprentissage entre pairs (groupes de parole féministes, squats, infokiosques) ;
– Éducation populaire radicale : transmission partielle de ces savoirs à des publics plus larges, dans un but de politisation et d’entrée dans l’action ;
– Pédagogie publique radicale : interventions dans l’espace public hors cadre scolaire ou associatif (Sandlin, O’Malley & Burdick, 2011).
Ce cadre m’apparaît particulièrement utile pour penser la pluralité des formes éducatives critiques. Il ne s’agit plus de choisir entre institution ou marge, mais de penser leurs circulations, leur dialectique. Cela rejoint mes propres réflexions sur la complémentarité des espaces de formation politique.
Conclusion
En définitive, en dissociant ouvertement les raisonnements de l’éducation radicale autonome et celles de l’éducation populaire institutionnalisée, Irène Pereira appréhende l’éducation populaire institutionnalisée tel un dispositif de transformation sociale et propose un cadre analytique facilitant un profond réexamen des conduites éducatives et des orientations, à la lumière des luttes sociales contemporaines. En tant que lecteur, cette lecture m’a permis de reconfigurer ma compréhension de l’éducation critique : au-delà des intentions, elle doit se penser dans un rapport permanent au politique, à l’autonomie et au conflit.
Se fait jour alors une éducation populaire que l’on peut concevoir tel un lieu de représentation et de communication des connaissances émanant de la formation autodidacte des franges actives minoritaires, ainsi qu’un lieu privilégié pour la médiation. L’auteure souligne l’obligation de conserver une corrélation organique entre conduites d’autonomie collective et institutions éducatives critiques, afin de contrer les dangers de la dépolitisation et la récupération.
Je retiens de cette lecture qu’un programme d’éducation visant l’émancipation, solidement enraciné dans les dynamiques de lutte et les réalités sociétales, suppose une vigilance politique constante et un engagement personnel profond — des exigences qui me paraissent aujourd’hui indispensables.
Réponse d’Irène Pereira
Merci pour votre lecture.
Je me permets de répondre à deux de vos interrogations qui sont en lien, il me semble :
« Cependant, je me demande si cette horizontalité pure est réellement praticable à large échelle, ou si elle ne risque pas de rester cantonnée à des groupes très politisés, déjà autonomes. » […] « Toutefois, cette lecture appelle aussi à une vigilance : une insistance exclusive sur les minorités agissantes peut écarter les enjeux de massification ou de médiation des savoirs. »
Mon propos, comme je le souligne dans l’article, n’est pas d’affirmer qu’il s’agit de ne prôner que l’éducation radicale comme autoformation dans un groupe de pair. Je constate l’existence d’une différence entre les groupes qui repose sur cette structure — comme les groupes de conscience féministe — et l’éducation populaire — qui me semble se structurer sur la dichotomie « l’éducateur et le peuple ».
Il me semble important de développer de ne pas en rester à l’autoformation radicale, mais de développer une éducation populaire radicale qui effectivement repose sur des minorités agissantes. En effet, je considère que l’éducation populaire radicale a pour fonction de faire passer des individus au statut de minorités actives pratiquant l’action directe.
Il me semble que les mouvements sociaux illustrent mon propos. Si on prend le mouvement contre la réforme des retraites, il montre que le mouvement était très largement soutenu dans la population, mais seulement une minorité participait aux manifestations. De manière générale, je ne pense pas qu’il y ait un exemple dans l’histoire où la majorité numérique d’une population ait participé aux actions directes des mouvements sociaux, même quand ceux-ci ont été victorieux. Il en va de même lors de révolutions.
En revanche, il me semble que le rôle de la pédagogie publique radicale peut être de favoriser ce soutien large de la population. Il me semble qu’il y a une distinction sur ce plan entre l’éducation populaire radicale (tournée vers l’action) et la pédagogie publique radicale (tournée vers le travail de conviction).
- Il est l’auteur du site Internet : Regards sur le travail social — https://andredecamp.fr/ ↩︎
Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.
Pour citer cet article :
Tribune libre #16 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ? Discussion entre André Decamp et Irène Pereira sur l’éducation radicale. André Decamp, Regards sur le travail social, 24 juin 2025. https://andredecamp.fr/2025/06/24/tribune-libre-16-discussion-entre-andre-decamp-et-irene-pereira-sur-leducation-radicale/
-
Tribune libre #15 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ?
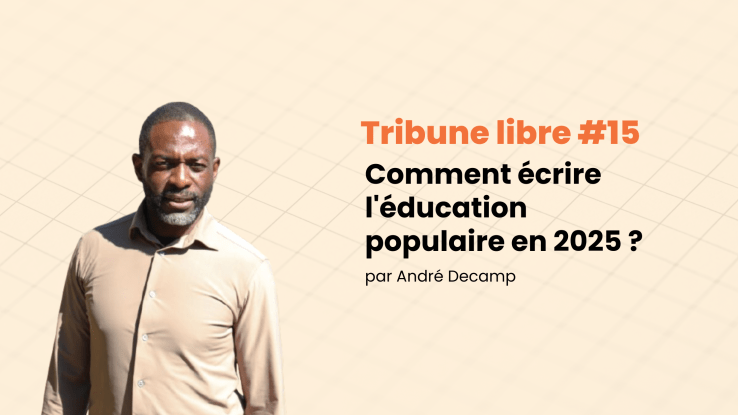
Matière à penser : La politique des contrôles des frontières permettra-t-elle de contenir les mobilités et les migrations ?
Par André Decamp1
Ce texte est issu de notre travail au cours du certificat inter-universités en Migrations, diversité ethnique et relations interculturelles (promotion 2020-2021)
https://www.ulb.be/fr/programme/fc-418Résumé :
Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, les frontières ont évolué de manière inattendue, révélant un paradoxe profond entre l’espoir d’ouverture et la réalité d’un monde qui multiplie les barrières. Alors que beaucoup imaginaient un monde plus ouvert, les murs n’ont cessé de se multiplier, visant désormais à isoler les populations selon leur niveau de richesse plutôt qu’à répondre à des impératifs militaires. La frontière constitue une réalité complexe, à la fois institutionnelle, spatiale et pratique. Ainsi, la politique migratoire s’est progressivement transformée en une politique de contrôle des frontières, accentuant par là même les inégalités sociales. Ce durcissement s’accompagne d’un sentiment croissant de « lassitude à l’égard de la solidarité » dans l’opinion publique, favorisant ainsi la montée des idées nationalistes.
Introduction
Les migrations se composent d’une immigration forcée (esclavage, demande d’asile et aujourd’hui climatique) et d’une immigration volontaire (vie meilleure en termes de travail, santé et statut social). Seule une approche sociologique interdisciplinaire peut permettre d’appréhender ces raisons économiques, sociales et politiques.
La sociologie de l’immigration[1] (Rea, A., 2021) présente deux problématiques : la migration en tant que telle, et l’installation des immigrés dans le pays. La première engage l’explication du mouvement de migration et des dispositifs de politiques publiques des pays qui l’encadrent. La seconde s’axe sur l’installation sociale, culturelle et économique des migrants.
Ancrées dans une représentation sociale de la problématique posée ou imposée[2], les politiques migratoires et de contrôle des frontières doivent être comprises comme un « ensemble de dispositifs de gestion des flux qui entrent et sortent d’un territoire de juridiction donné ainsi que le discours sur la menace transfrontalière »[3].
Rea[4] nous engage à différencier les politiques migratoires (lutte contre les discriminations, intégration des migrants, citoyenneté et nationalité) et les politiques de contrôle des frontières relatives à l’octroi de l’asile ou du visa, la gestion du regroupement familial et l’immigration irrégulière[5]. En effet, des écarts nationaux importants subsistent et des trajectoires de groupes d’états peuvent être déterminées autour de réalités communes[6].
Par exemple, les expériences des pays de tradition de droit du sol et de tradition de droit du sang tendent à se rapprocher : en Allemagne et en Belgique, l’usage du droit du sol se diffuse pour les descendants de migrants, tandis que les pays de tradition civique durcissent les conditions d’application du droit du sol pour les deuxièmes générations (Royaume-Uni, Irlande). Pour les seconds, le consensus politique et les processus de convergence sont beaucoup plus nets en matière de politiques répressives et de contrôle.
Frontières « les nouveaux murs »
Avec la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, nous avons cru les murs amenés à disparaître alors qu’ils se sont multipliés depuis quelques années, à tel point que certains états membres ont dû reporter le rôle de contrôle de leurs frontières vers l’enveloppe externe de l’Union européenne (UE) pour se conformer aux accords de Schengen[7]. Actuellement, ces murs servent à isoler les populations selon leur niveau de vie, et non à contenir une force militaire. Assurer la sécurité économique et contrôler les flux et trafics est leur principal objectif.
Selon Anne-Laure Amilhat-Szary « une frontière, ce n’est pas une institution qui ensuite se traduit dans l’espace et va faire l’objet de respect ou de détournement par les pratiques ; c’est vraiment trois choses à la fois qui fonctionnent en même temps : 1) une institution ; 2) des pratiques ; 3) une démarcation, une spatialisation, une matérialité »[8].
Pour G. Neuman, juriste (1996) et F. Infantino (2019), nous ne sommes plus dans la représentation de la frontière vécue comme une ligne, mais dans une figure d’« Anomalous Zones » du point de vue du droit (telles les zones d’attente dans les aéroports ou les 20 km compris dans l’espace de Schengen). Paradoxalement, les contrôles des frontières se jouent aux avant-postes de la frontière physique, les compagnies aériennes disposant des données des passagers avant même que ces derniers n’arrivent sur le sol. Idem pour les consulats délivrant des visas : la politique de contrôles de la migration ne s’effectue plus à la frontière physique, mais ailleurs.
Pour Didier Bigo et Guild (2005), « l’Europe n’est ni une forteresse ni une passoire » et une telle vision mérite d’être dépassée. Pour Massey (2005) ; Bocker et Havinga (1998), les flux migratoires ont des dynamiques multiples, contradictoires et irréductibles à une tendance unique qui serait à l’œuvre entre des logiques répressives et d’autres, plus libérales. Les politiques publiques migratoires ou les politiques de contrôles de frontières n’impactent en rien les décisions des migrants de quitter leur pays : « Il ne faut pas oublier que les principaux bénéficiaires de cette politique sont des acteurs bureaucratiques nationaux, essentiellement issus des ministères de l’Intérieur et de la Justice qui ont renforcé leur position »[9]. Pour Sassen (1996), « la militarisation de la frontière physique aux États-Unis ou en Europe n’a pas réduit les échanges financiers, commerciaux ainsi que les flux migratoires. En effet, à ce jour, le phénomène continue et même augmente ». En somme, la politique des contrôles des frontières ne permet pas de contenir les mobilités ni les migrations.
Les migrations vues à travers le prisme économique
Pourtant, la Banque Nationale de Belgique a mené une étude selon laquelle les flux migratoires ont eu une incidence positive sur le PIB sur les cinq dernières années (+3,5 %). Les conséquences sont aussi positives s’agissant les flux d’immigrés d’origine européenne (+2 %) que les flux extraeuropéens (+1,5 %). On peut également constater qu’en matière de salaires, participation, bien-être, revenu net ou chômage, l’immigration n’a eu aucun effet préjudiciable sur les natifs[10].
« Pour stabiliser la population active (20-59 ans) à 34 millions de personnes en 2050 (pour 33 millions en 2012), il faudrait, selon l’Insee, recourir à un flux de 150 000 entrées nettes d’immigrés par an[11] ».
Ainsi, « ce n’est ni en s’alliant ni en s’aliénant l’opinion publique qu’on fait de la bonne recherche, c’est en soulevant l’intérêt par la qualité des méthodes et des résultats, par la soumission aux épreuves et aux contre-épreuves »[12].
Conclusion
Depuis des années, la politique migratoire semble s’être transformée en politique de contrôle des frontières dans un accroissement des inégalités sociales. Une « lassitude de solidarité s’est accaparé l’opinion publique » pour laisser place au nationalisme.
Plus les politiques de contrôles de frontières sont importantes, plus l’opinion s’oriente vers les idées nationalistes, racistes et populistes. Ce nouveau paradigme catalyse la « tyrannie de la malchance de la loterie » du lieu où les migrant.e.s sont né.e.s.
Il existe pourtant « entre l’angélisme de la doctrine des frontières ouvertes et l’hypocrisie de la doctrine de l’immigration zéro (…) un espace pour une politique européenne proactive de l’immigration basée sur des critères clairs et démocratiques tenant compte des désirs et des besoins de tous et reconnaissant simplement le principe de la liberté individuelle de rechercher ailleurs sur la planète le bien-être que l’on n’a pas chez soi » (Martiniello, M., 2001.p.8).
Liste de références
Anderson, M. (1997). Les frontières : un débat contemporain. Cultures & Conflits, (26-27).
Anderson, M., & Bort, E. (Eds.). (1998). The frontiers of Europe. A&C Black.
Jones-Correa, M. (2002). Border Games : Policing the US Mexico Divide.
Andreas, P., & Snyder, T. (Eds.). (2000). The wall around the West: State borders and immigration controls in North America and Europe. Rowman & Littlefield.
Bigo, D. (1996). Polices en réseaux. L’expérience européenne. Presses de Sciences Po.
Bigo, D., & Guild, E. (Eds.). (2005). Controlling frontiers: Free movement into and within Europe. Ashgate Publishing, Ltd.
Böcker, A., & Havinga, T. (1998). Asylum migration to the European Union: Patterns of origin and destination. Luxembourg : Office for official publications of the European Communities.
Infantino, F. (2019). Schengen visa implementation and transnational policymaking: Bordering Europe. Springer.
Martiniello, M. (2001). La nouvelle Europe migratoire. Pour une politique proactive de l’immigration. Quartiers Libres.
Massey, D. (ed.), Worlds in Motion, Oxford, Oxford University Press, 2005
Neuman, G. L. (1995). Anomalous zones. Stan. L. Rev., 48, 1197.
Sassen, S. (1996). Losing control?: sovereignty in the age of globalization. Columbia University Press.
[1]Rea, A. (2021). Sociologie de l’immigration. Paris : La Découverte.
[2]Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2018). Sociologie de l’action publique-2e éd. Armand Colin.
[3]Guiraudon, V. (2008). Chapitre 6 : Les politiques de gestion des frontières et de l’immigration. Dans : Olivier Borraz éd., Politiques publiques 1: La France dans la gouvernance européenne (pp. 173-194). Paris: Presses de Sciences Po. https://doi.org/10.3917/scpo.borra.2008.01.0173″
[4]Rea, A. (2021). Sociologie de l’immigration. Paris: La Découverte.
[5]Ibid
[6]Ibid
[7]Le 26 mars 1995, les Accords de Schengen fixent comme objectif l’abolition des contrôles systématiques aux frontières intérieures.
[8]Amilhat-Szary, A. L. (2015). Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui?. Presses universitaires de France.
[9]Guiraudon, V. (2008). Chapitre 6 : Les politiques de gestion des frontières et de l’immigration. Dans : Olivier Borraz éd., Politiques publiques 1: La France dans la gouvernance européenne (pp. 173-194). Paris: Presses de Sciences Po.
[10]https://www.nbb.be/fr/articles/limpact-economique-de-limmigration-en-belgique 04 novembre 2020
[11]https://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/economie-et-immigration/l-immigration-peut-elle-ralentir-le-vieillissement
[12]Héran, F. (2007). Le temps des immigrés. Essai sur le destin de la population française. Lectures, Les livres.
Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.
Pour citer cet article :
Tribune libre #15 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ? Matière à penser : La politique des contrôles des frontières permettra-t-elle de contenir les mobilités et les migrations ? André Decamp. André Decamp, Regards sur le travail social, 12 mai 2025. https://andredecamp.fr/2025/05/12/tribune-libre-15-comment-ecrire-leducation-populaire-en-2025/
-
Tribune libre #14 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ?
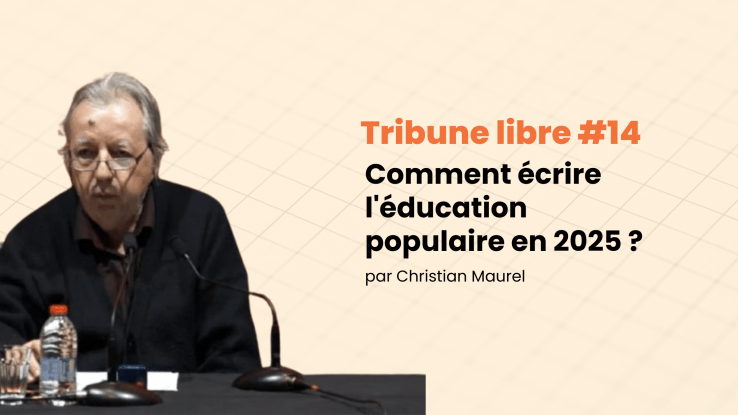
Des transformations de société à la transformation sociale et politique : quelles places et fonctions des communs et de l’économie sociale et solidaire ?
Par Christian Maurel1
Cet article est une republication d’une contribution originale de Christian Maurel au cours de la Session 5 : vendredi 27 mai 9h30-11h de l’ Atelier 5.4. « Communs, ESS et enjeux méthodologiques », issu de la XVIe Rencontres Inter-universitaires de l’Économie Sociale et Solidaire – RIUESS – Montpellier, 25.27 mai 2016.
Résumé :
Les pratiques d’Économie Sociale et Solidaire, associées à une utilisation collaborative des NTIC et à un retour du commun comme principe instituant, portent en germe une transformation sociale et politique dont les femmes et les hommes de toutes conditions sont appelés à être les auteurs et les acteurs.
Et si ce processus inédit dans l’histoire de l’humanité avait cette triple vertu indispensable à toute révolution, de modifier profondément les rapports socio-économiques, de dessiner les contours d’un nouvel imaginaire social et de contribuer à la nécessaire éducation populaire politique conduisant les individus à penser et à construire collectivement un nouveau devenir ?
À une condition essentielle : que la mondialisation libérale ne parvienne pas à désarmer et à annihiler ce qui la contredit. Un combat est engagé entre les tenants du tout marché comme « fin de l’Histoire » et ceux qui aspirent à en écrire une nouvelle page.
Mots clés : transformation, imaginaire social, éducation populaire, communs, révolution.
Le développement fulgurant des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication modifie en permanence les rapports de travail, les rapports au travail, les rapports entre temps libre et temps de travail, les rapports aux savoirs, les rapports pédagogiques, familiaux, interindividuels, de soi à soi… Comment ces transformations de société, de l’économique à l’intime, ouvrent-elles des perspectives de transformation sociale dans lesquelles les femmes et les hommes de toutes conditions cherchent à s’émanciper de ce qui les contraint pour écrire une nouvelle page de leur histoire ?
Dans le domaine économique, la construction de communs échappant à la propriété privée individuelle et à la propriété publique, dont l’économie sociale et solidaire est la forme la plus élaborée, n’est-elle pas en train, au moment au nous parlons, de remettre en cause les rapports de production, de consommation et de propriété hérités du capitalisme industriel ? Alors que le libéralisme économique semble devoir régner sans partage sur la planète, les bouleversements en cours « qu’on peut constater d’une manière scientifiquement rigoureuse »[1]— et c’est un des enjeux de ce colloque — ne s’apparentent-ils pas à une forme de « révolution sociale » [2]qui en appelle d’autres (juridiques, politiques, culturelles, éducatives…) dans lesquelles les hommes prendraient réellement conscience de ces bouleversements et s’engageraient dans leur dépassement ?
Nous mesurons bien la difficulté d’esquisser et de mettre en discussion un modèle explicatif permettant de mieux appréhender les modes actuels d’organisation et surtout de transformation d’un monde de plus en plus globalisé et soumis aux bouleversements générés, souvent de manière contradictoire, par un développement scientifique et technologique fulgurant, par une économie de marché de plus en plus prégnante, mais aussi par des aspirations fortes et de plus en plus massives à une économie collaborative et à une société du partage, sans oublier l’affaiblissement des États dits « démocratiques » et les modes nouveaux de mobilisation, de résistance et de lutte qui s’organisent en réseau.
Commençons par une préoccupation de langage : il ne faut pas confondre les transformations de société (expression toujours au pluriel) dans lesquelles les hommes sont pris — qu’ils en profitent, au moins momentanément, ou qu’ils les subissent, souvent pour longtemps — et la transformation sociale et politique (expression généralement au singulier) dans laquelle les hommes s’engagent individuellement et collectivement dans la modification de rapports sociaux, juridiques et politiques qu’ils jugent inacceptables. Les transformations de société (aujourd’hui, le redéploiement des inégalités, les crises à répétition, le chômage de masse mais aussi l’expérimentation de manières nouvelles de produire, de se nourrir, d’habiter…) ne conduisent pas mécaniquement à la transformation sociale et politique (nouveaux droits et régimes de propriété, nouvelles institutions politiques, réorganisation des pouvoirs de décision et de gestion…). Pour que l’on puisse parler de transformation sociale et politique, il est besoin de l’intelligence, de l’imaginaire et de l’engagement de femmes et d’hommes qui y ont intérêt.
Ainsi, sommes-nous conduits à adopter une position de principe qui, jusqu’à preuve du contraire, nous parait juste : les hommes qui sont les « produits » de l’Histoire sont, en même temps, les seuls à pouvoir faire l’Histoire. Il s’agit alors de voir et de comprendre comment les hommes et les femmes peuvent être amenés à prendre appui sur les transformations de société de tous ordres (technico-scientifiques, économiques, sociales…) pour s’engager dans les transformations sociales et politiques qu’ils jugent nécessaires, par des pratiques intellectuelles, culturelles, idéologiques, d’éducation mutuelle… porteuses de prises de conscience, d’émancipation et de capacités à agir nouvelles.
Ces précautions essentielles ramenées à la question des communs et de l’Économie Sociale et Solidaire ouvrent sur quelques remarques et propositions :
L’Économie Sociale et Solidaire, tant dans ses formes actuelles qu’au moment du mouvement ouvrier émergeant au 19e siècle, apparait comme autant de modes de production, de consommation et de gestion contradictoires avec « le libéralisme d’un marché autorégulateur » et le développement d’une « société de marché » [3]pour lesquels tout, y compris les services publics, doit se penser en termes de productivité, de performance et de profit. Et ce n’est pas un hasard si l’Économie Sociale et Solidaire ainsi qu’une philosophie et une sociologie des communs connaissent, aujourd’hui, un développement remarqué au moment où, comme au 19e siècle, l’économie se « désencastre de la société » [4]et tente d’imposer sa loi sur tous les domaines de l’activité humaine (santé, culture, recherche, éducation, création artistique…). En effet, c’est bien parce que l’économie de marché et sa financiarisation sont difficilement contrôlables que les individus et le corps social réagissent de deux manières contradictoires : le repli sectaire, communautariste et nationaliste ou, au contraire, l’engagement dans la construction de communs et dans des pratiques coopératives et solidaires.
Ainsi, dans cette période où le nouveau peine à naitre et « que s’ouvre devant nous une longue période de convulsions, d’affrontements et de bouleversements » [5], une sorte de course poursuite est engagée entre deux scénarii : l’un catastrophique, celui du règne de la violence et des oppressions de toutes sortes ; l’autre, celui de la construction de rapports économiques, sociaux et politiques plus égalitaires et résolument démocratiques.
Comme nous le montrent certains phénomènes actuels (d’un côté la violence organisée, de l’autre le développement de coopérations solidaires), les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication peuvent servir les deux scénarii. Les savoirs et les techniques ne sont jamais neutres notamment dans les périodes de bouleversement social. Dans le même temps et à la différence des précédentes révolutions technologiques (la vapeur, l’électricité, le pétrole…), la révolution actuelle est, tout à la fois et dans le même mouvement, économique, sociale, politique et culturelle. Elle ne concerne pas d’abord les rapports économiques de production avant de gagner un peu plus tard et progressivement les autres champs de l’activité humaine et les autres rapports sociaux (politiques, culturels, interpersonnels, cognitifs…). Les individus, les groupes sociaux et les sociétés se trouvent confrontés d’emblée à des bouleversements inédits et de tous ordres, qui touchent au travail, à la vie quotidienne voire à l’intimité de chacun.
Ainsi s’agit-il de bien mesurer pourquoi et comment avec le support des nouvelles technologies et dans les différentes formes d’économie sociale et de pratiques solidaires (SCOP, Mutuelles, associations, ONG, mouvements sociaux), se construit patiemment mais résolument, au quotidien et en situation, un « imaginaire social » [6]pouvant jeter les bases d’un « social-historique »[7] nouveau construit autour de communs, de valeurs, de significations, de savoirs, de pratiques de coopération et de démocratie réelle. Seul un tel imaginaire social peut nous permettre de combattre cette « montée de l’insignifiance » [8]du tout marchand et, tout à la fois, cette prolifération d’imaginaires fermés, sectaires, ségrégationnistes, nationalistes et fondamentalistes pour lesquels rien n’est discutable et qui très souvent ne connaissent que la violence.
Si on veut que cette complexité soit plus lucidement appréhendée et que les enjeux puissent être compris par ceux qui ont intérêt à la transformation sociale et politique d’un monde qui ne peut rester longtemps en l’état, nous préconisons, à la lumière d’autres moments de l’Histoire (les Cahiers de doléances de 1789, la naissance du mouvement ouvrier, l’affaire Dreyfus, la Libération…), le soutien, la reconnaissance publique et la mise en œuvre d’initiatives et de démarches d’éducation populaire politique. Cette éducation populaire politique qui ferait le choix de la construction mutuelle des savoirs et des expériences plutôt que celui de la leçon faite au peuple, a clairement deux formes complémentaires, l’une « organique » faisant corps avec le mouvement social lui-même (et à ce titre, la construction de communs et l’économie sociale et solidaire sont des espaces d’éducation populaire mutuelle), l’autre que nous qualifions de « propédeutique » parce que préparatoire à l’engagement social et politique, ce qui doit être la mission des associations, mouvements et fédérations « agréés d’éducation populaire ».
C’est à cette seule condition que les individus et les groupes sociaux pourront se donner collectivement les formes juridiques, philosophiques, scientifiques, artistiques, pédagogiques, leur permettant de prendre conscience des contradictions, des bouleversements et des crises qu’ils subissent pour les conduire à leur résolution et à leur dépassement, et ainsi s’engager dans un parcours d’émancipation. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication par le partage des savoirs et des expériences qu’elles permettent, ainsi que les pratiques d’Économie Sociale et Solidaire et de construction des communs, doivent favoriser cette éducation populaire politique et mutuelle porteuse d’un nouvel imaginaire social. Ainsi, nouvelles technologies et économies solidaires peuvent trouver leur place et leur rôle à la fois dans les transformations de société par la remise en cause d’un système socio-économique néfaste à brève échéance pour l’Humanité, et dans les engagements individuels et collectifs de transformation sociale visant à construire un nouveau devenir.
Ces deux dimensions — les transformations de société et la transformation sociale et politique — doivent nous conduire à repenser les relations entre les intellectuels et le peuple qui marquent à la fois — et ce n’est pas un hasard — l’histoire du mouvement social et celle de l’éducation populaire. Il s’agit de dessiner une nouvelle figure de l’intellectuel qui ne se limite pas à la critique, y compris la plus radicale de la réalité du monde, même si cette dernière est nécessaire. Nous appelons de nos vœux l’engagement de deux nouveaux types d’intellectuels qui ne se situeraient pas en position de surplomb mais adopteraient une posture qui est celle d’être d’aplomb avec le réel et avec les gens qui y vivent. Le premier type est celui de l’intellectuel « praxéologue » qui se donne pour mission d’identifier, de décrire et d’analyser les pratiques de transformation sociale et politique et d’en socialiser les savoirs de la pratique dans le but d’en faire un bien commun. Ainsi, il n’y a pas que l’économie qui peut être sociale et solidaire. Les savoirs sociaux et d’expérience doivent également le devenir si l’on veut que se construise une intelligence collective d’un nouveau projet de société réellement partagé. Un nouveau dispositif à trois pieds pourrait alors se mettre en place, associant les expériences de transformation sociale et politique aussi modestes soient-elles (on pense à ce « million de révolutions tranquilles » [9]dont parle Bénédicte Manier), les apports cognitifs des intellectuels praxéologues, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication à l’image, par exemple, du site « Éducation populaire et transformation sociale » que nous sommes quelques-uns à animer.
Mais il y a un autre type d’intellectuel complémentaire du précédent et qui aurait toute sa place dans les processus de transformation sociale et politique. On a encore bien du mal à le définir. Nous hésitons entre « intellectuel opérationnel », « intellectuel citoyen », « intellectuel ou chercheur en résidence ». En 2006, Pierre Rosanvallon en donnait déjà une approche assez précise quand il parlait de « l’intellectuel impliqué, chercheur associé à la société civile, celui qui produit à la fois l’outil et la critique »[10]. Cette approche qui, avec l’expérience, devrait connaitre des évolutions, nous fait penser, par exemple, à Miguel Benasayag accompagnant les travaux de l’Université Populaire-Laboratoire Social de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ris-Orangis en banlieue parisienne ou encore au sociologue clinicien du travail, Pierre Roche, engagé dans des parcours d’émancipation et de « subjectivation » [11] impliquant des conducteurs de train, des aides-soignantes, des femmes en formation et en recherche d’emploi, des éducateurs spécialisés confrontés à des jeunes impliqués dans l’économie parallèle de la drogue.
Il est nécessaire et urgent que l’Économie Sociale et Solidaire ne soit pas considérée comme un mode de gouvernance parmi d’autres (privée, publique) — que donc on ne la banalise pas — mais que pour les acteurs eux-mêmes elle fasse sens et mouvement social au service de la construction de ce que Jacques Rancière appelle une « subjectivation collective » ouvrant sur une nouvelle histoire. La crainte existe toujours que l’Économie Sociale et Solidaire ne soit conduite, dans un rapport de force qui ne lui est pas encore favorable, à adopter les langages et les modes de « gouvernance » du libéralisme économique, ce qui lui ferait perdre sa portée sociale et politique de contestation et de transformation. En revanche, c’est précisément l’adoption du commun comme principe régulateur et une utilisation fermement collaborative des nouvelles technologies qui peuvent en faire une « praxis instituante » [12]consciente de sa portée politique, préparatoire à « ce moment d’accélération, d’intensification et de collectivisation » [13]que Pierre Dardot et Christian Laval nomment tout simplement « révolution » et que Castoriadis décrivait comme « l’autotransformation de la société dans un temps bref »[14].
Autrement dit et pour faire court, comment ces trois révolutions en cascade (technologique, sociale et politique) peuvent-elles ouvrir une nouvelle perspective à une humanité prise dans un monde de convulsions morbides et d’affrontements violents ? La révolution ne se décrète pas. Un long travail préalable est indispensable. Une Économie Sociale et Solidaire bien pensée et surtout bien conduite peut alors s’imposer comme un espace et un moment essentiels et incontournables de ce travail.
Références bibliographiques.
- Dardot P. et Laval C. (2014), Commun. Essai sur la révolution au 21e siècle, Paris, Éditions La Découverte.
- Castoriadis C. (1975), L’institution imaginaire de la société, Paris, Éditions du Seuil.
- Castoriadis C. (1996), La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe IV, Paris, Éditions du Seuil.
- Gaulejac (de) V., Hanique F. et Roche P. (2007), La sociologie clinique. Enjeux théoriques et méthodologiques, Ramonville Saint-Agne, Éditions Erès.
- Manier B. (2012), Un million de révolutions tranquilles, Paris, Éditions Les Liens qui Libèrent.
- Marx K. (1972), Contribution à la critique de l’économie politique, Paris, Éditions Sociales. Polanyi K. (1983), La grande transformation, Paris, Éditions Gallimard.
[1] K. Marx : Contribution à la critique de l’économie politique (Préface), p. 4.
[2] Ibid., p.4.
[3] K. Polanyi, La grande transformation.
[4] Ibid.
[5] P. Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au 21e siècle, p. 569.
[6] C. Castoriadis, L’institution imaginaire de la société.
[7] Ibid.
[8] C. Castoriadis, La montée de l’insignifiance.
[9] B. Manier, Un million de révolutions tranquilles.
[10] P. Rosanvallon, Le Monde du 20 Mai 2006.
[11] P. Roche, La sociologie clinique.
[12] P. Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au 21e siècle, p. 575 et suivantes.
[13] Ibid., p. 575.
[14] C. Castoriadis, entretien avec François Dosse, 24 novembre 1987, cité par P. Dardot et C. Laval, Commun. Essai sur la révolution au 21e siècle, p. 575.- Christian Maurel, sociologue de la culture et de l’éducation populaire “politique”, ancien directeur de MJC puis délégué de la Fédération Française des MJC en région “Méditerranée”, ancien professeur associé à l’Université de Provence (Aix-Marseille I), ancien président du Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie Associative en PACA. ↩︎
Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.
Pour citer cet article :
Tribune libre #14 Comment écrire l’éducation populaire en 2025 ? Des transformations de société à la transformation sociale et politique : quelles places et fonctions des communs et de l’économie sociale et solidaire ? Christian Maurel. André Decamp, Regards sur le travail social, 23 avril 2025. https://andredecamp.fr/2025/04/23/tribune-libre-14-comment-ecrire-leducation-populaire-en-2025-2/
-
Tribune libre #13 Comment écrire l’éducation populaire en 2024 ?
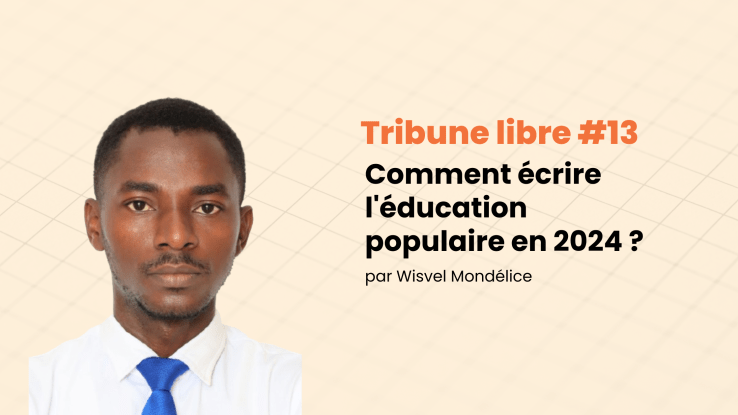
Les centres d’éducation populaire en Haïti : entre le maintien de l’identité et le défi de préserver des lieux d’expérimentation
Par Wisvel Mondélice1
« C’est en vivant – peu importent les faux pas et les incohérences, l’important étant d’être disposé à les surmonter – que je contribue à créer l’école joyeuse, à forger l’école heureuse, l’école qui est aventure, qui avance, qui n’a pas peur du risque et qui pour cette raison même se refuse à l’immobilisme, l’école au sein de laquelle on réfléchit, dans laquelle on agit, dans laquelle on crée, dans laquelle on parle, dans laquelle on aime, l’école, vous le devinez, qui dit « oui » à la vie avec passion. Et non pas l’école qui lasse et qui me lasse. »
Paulo FreireIntroduction
Certaines valeurs et pratiques véhiculées au sein des classes populaires en Haïti ont précédé la notion d’éducation populaire ayant pris son élan à la fin du XIXème siècle. Diverses courroies ont favorisé cette transmission : le vaudou, les musiques traditionnelles, les contes oraux, les devinettes, etc. La mise en place des centres d’éducation populaire à partir des années 1970 dans le pays a institutionnalisé les pratiques visant à une prise de conscience collective des classes populaires de certains enjeux, mais également au changement de leurs conditions de vie. Les Communautés ecclésiales de base (CEB)[1] appelées Ti Kominote Legliz (TKL) en créole haïtien, ayant été développées surtout à partir de 1979 (Corten, 2000 : 65), se révèlent un moment important dans le processus de la création de ces centres, lesquels se sont multipliés à partir de ce moment.
En agréant la demande qui nous a été faite de contribuer à cette Tribune libre, nous ne faisons que mettre en relief des pistes de réflexion sur l’éducation populaire en Haïti, en prenant certainement en compte le contexte d’évolution des institutions qui s’en revendiquent.
Vu « la contrainte éditoriale » de cette demande, nous faisons l’économie de trois aspects : l’historique de l’éducation populaire hors d’Haïti, la théorie de l’éducation populaire et les conceptions[2] des acteurs de ce mouvement en Haïti. Nous nous focalisons de préférence sur d’autres éléments concernant cette dynamique dans le pays, en considérant le cas de deux centres : Sosyete animasyon ak kominikasyon sosyal (SAKS)[3] et l’Institut culturel Karl Lévêque (ICKL). Il s’agira, au-delà de leur présentation, de mettre l’emphase sur leurs réalisations en lien avec notre objectif et les difficultés rencontrées. D’abord, faisons un coup d’œil sur l’origine et l’évolution de ce mouvement dans le pays.
Origine et évolution de l’éducation populaire en Haïti
Le début de l’éducation populaire dans le pays date des années 1970, surtout avec la naissance des centres de pastorale sociale[4] dans l’Église catholique (Joint, 1996 : 31-32). En voici la liste présentée par l’auteur : Développement communautaire des chrétiens haïtiens (DCCH) en 1971, Institut de développement et d’éducation des adultes (IDEA) en 1973, Centre « EMMAUS » en 1972, Institut technique d’animation (ITECA) en 1976, Projet régional pour le développement (PRED), Centre de « MADIAN » en 1976, Centre de « SALAGNAC » en 1973. Parallèlement à ces institutions, des instances informelles d’éducation populaire se sont formées ou développées selon le même modèle et la même approche (Ibid.).
D’autres institutions qui se revendiquent de l’éducation populaire ont vu le jour au fil des années, parmi lesquelles : Institut culturel Karl Lévêque (ICKL) en 1989, Centre œcuménique de développement et d’éducation populaire (CEDEP) en 1990, Sosyete animasyon ak kominikasyon sosyal (SAKS) en 1992, Platfòm ayisyen k ap plede pou yon devlopman altènatif (PAPDA)[5] en 1995.
Dans le contexte répressif de la dictature des Duvalier[6], les centres d’éducation populaire « ont favorisé discrètement un processus de conscientisation et d’organisation » (Ibid.). Outre la conscientisation servant de base à l’ensemble de leurs actions, ceux créés à la chute du régime interviennent sur des axes définis en fonction des enjeux et thématiques prioritaires du nouveau contexte, des compétences académiques et politiques de leurs fondateurs/fondatrices ou des vœux exprimés par des organisations partenaires de terrain. Démocratie, participation citoyenne, changement climatique, agroécologie, souveraineté alimentaire, droits humains, redditions de compte et luttes contre la corruption et l’impunité, économie sociale et solidaire (ESS), réseautage organisationnel et mobilisations populaires, droit à la communication, sont quelques enjeux et thématiques de travail des centres d’éducation populaire aujourd’hui. Les deux prochaines parties de ce travail sont consacrées à deux centres distincts : Sosyete animasyon ak kominikasyon sosyal (SAKS)[7] et l’Institut culturel Karl Lévêque (ICKL).
Le cas de Sosyete animasyon ak kominikasyon sosyal (SAKS)
Créée le 28 octobre 1992, journée de la commémoration internationale de la langue et de la culture créoles, cette fondation se donne pour mission « d’accompagner la lutte du peuple haïtien pour le changement social ». Sa contribution dans le champ de l’éducation populaire se fait par la communication, dont elle fait la promotion comme un droit fondamental, en aidant les secteurs populaires et progressistes à s’approprier les outils.
SAKS poursuit les objectifs suivants : – promouvoir la communication comme outil d’éducation et de conscientisation ; – promouvoir la communication comme un droit fondamental ; – permettre aux organisations populaires, aux ONG, aux institutions sociales d’acquérir une formation théorique et technique en matière de communication sociale ; – permettre aux organisations de base de s’approprier les outils de communication, au profit de l’éducation des masses et de la lutte.
Les radios communautaires constituent le principal lieu d’intervention de SAKS et la formation, son activité-phare. Chez SAKS, la radio communautaire s’étend à une catégorie « incluant les radios populaires[8], mais celles qui sont au service de la communauté, en général » (Estéus, 2013 : 42). Ces radios se positionnent dans le camp populaire, en servant les intérêts des gens les plus défavorisés… (Ibid. : 43).
Depuis son existence, SAKS participe à la mise en place des radios communautaires dans les 10 départements du pays, comme moyen de construire une alternative de communication en harmonie avec le droit à l’information. L’histoire de cette institution est essentiellement liée à l’émergence et au développement de ces radios en Haïti (Ibid. : 38). Elle réalise des sessions de formation, à la fois technique et idéologique, pour des membres d’organisation voulant créer une radio communautaire ou sur demande d’une radio déjà créée.
Selon le manuel de formation de SAKS (2006 : 50), la radio communautaire [populaire] est définie à partir d’une série de critères[9], tels que : – un outil de communication populaire entre les mains des masses populaires – une radio favorisant la participation de la population – un instrument de lutte pour la libération des masses populaires et le changement de la société – une radio pour le renforcement de la culture populaire – une radio qui porte les revendications des masses populaires – une radio pour la prévention. Elle est gérée par une ou plusieurs organisations populaires, son fonctionnement est assuré par les membres de la population et elle est au service de celle-ci. L’éducation populaire dans les radios communautaires est donc un pas dans la longue marche des masses populaires pour parvenir à une autre société[10] (Reyneld, 1998 : 9).
La première expérience de radio communautaire haïtienne date de 1990. Il s’agit de Radyo Bwakayiman (Radio Bois-Caïman), située à Mare-Rouge, au Môle Saint Nicolas (Département du Nord-Ouest). Au début, cette radio n’avait pas pour mission d’être une radio d’expression communautaire à proprement dit. En ce sens, il y a lieu de considérer que les radios communautaires haïtiennes populaires naissent sous la période du coup d’État contre le président Jean-Bertrand Aristide[11], en 1992, lorsque SAKS se lançait avec deux radios. Leur création s’inscrit dans une démarche mondiale où des gens et des organisations, en proie à toutes sortes de difficultés, se servent des médias pour défendre les droits des classes populaires. En 1994, SAKS réalisait des formations pour 4 autres radios. En 2012, un réseau de plus de 40 radios communautaires et populaires, situées dans les 10 départements géographiques du pays, en particulier dans les sections communales, bénéficiait de son accompagnement. Ceci implique des séances de formation, des supports techniques et d’émissions[12] radiophoniques régulières. En 2024, le réseau de diffusion de SAKS renferme 53 radios communautaires.
Le cas de l’Institut culturel Karl Lévêque (ICKL)
Un extrait de la présentation de l’ICKL, disponible sur son site[13], mentionne les données suivantes exposées dans les deux prochains paragraphes. Ensuite, d’autres sont collectées à partir d’un questionnaire que nous avons soumis à Képler Aurélien, le coordonnateur du programme Recherche, innovation et systématisation de l’institut.
Créé en juillet 1989, l’Institut culturel Karl Lévêque se définit comme un centre d’intervention sociale et de recherche-action en éducation populaire qui entend apporter sa contribution aux luttes de libération des couches populaires de la société haïtienne. Il veut en effet : – encourager la réflexion critique continue sur les pratiques des mouvements sociaux et populaires – accompagner les communautés locales et les organisations des mouvements sociaux et populaires dans l’élaboration des solutions aux problèmes conjoncturels et structurels.
L’ICKL conçoit toutes ses activités dans une perspective d’éducation populaire. Son approche d’éducation populaire s’inscrit dans une vision large axée tant sur un travail de conscientisation autour des mécanismes d’exploitation et de domination que sur un accompagnement dans la création et la gestion d’alternatives socioéconomiques, dans une perspective d’économie sociale et solidaire. Ce dernier aspect offre aux communautés et aux groupes de base à la fois des moyens de subsistance et des micro-espaces d’expérimentation d’un projet de société fondé sur la gestion participative et la propriété collective des moyens de production et d’échange. Au début, les activités de l’institut auprès de ses partenaires de terrain[14] portaient sur la formation et le plaidoyer. Depuis une vingtaine d’années, l’économie sociale et solidaire fait partie de ses thématiques prioritaires.
Il y a plus de 20 ans, l’ICKL co-organise annuellement une université populaire de concert avec certains partenaires haïtiens que sont ITECA (Institut de technologie et d’animation), PAPDA (Platfòm ayisyen k ap plede pou yon devlopman altènatif[15]), PAJ (Programme pour une alternative de justice), SOFA (Solidarite fanm Ayisyèn[16]) et SAKS (Sosyete animasyon ak kominikasyon sosyal[17]). Il s’agit d’un espace de formation, de co-construction de savoirs et de pistes d’actions collectives entre des membres d’associations populaires urbaines, paysannes, syndicales, étudiantes, féministes, des enseignants/es-chercheurs/es, des intervenants/es sociaux/sociales. Sur les dix dernières années, l’université populaire s’est déroulée sur l’économie sociale et solidaire et la participation politique des mouvements sociaux et populaires. Cet espace de travail collectif a permis de construire une mémoire des expériences de ces mouvements.
Par ailleurs, l’institut accompagne des associations paysannes partenaires dans un travail de réseautage, la formation ainsi que la création et le développement d’entreprises sociales. Il offre un accompagnement pédagogique et financier à des écoles communautaires. Il appuie les directions de ces écoles dans un travail d’ancrage communautaire.
L’institut s’engage aussi dans la systématisation des expériences réalisées par ses partenaires de terrain et de ses propres expériences.
L’ICKL entame, depuis octobre 2024, un processus d’appui à l’organisation et à la protection des travailleuses domestiques qui sont très exposées à des abus favorisés par le caractère informel de leur emploi et leur isolement.
Les interventions de l’ICKL ont contribué à la vulgarisation de la philosophie et des pratiques de l’économie sociale et solidaire en Haïti. Elles ont contribué également au développement du pouvoir d’agir de certaines associations, tant en termes de capacité d’analyse et de mobilisation que sur le plan financier. Sur les cinq dernières années, les productions de l’institut et les espaces de débats qu’il a organisés ont réussi à mettre en relief les limites en matière d’efficacité d’un long travail d’éducation populaire réalisé dans le pays surtout à partir de 1986 et à poser la nécessité d’en renouveler l’approche.
Des défis de l’éducation populaire en Haïti à travers les expériences de SAKS et de l’ICKL
Les centres d’éducation populaire haïtiens éprouvent d’énormes difficultés à pérenniser des espaces d’expérimentation. Ils évoluent entre l’effort de maintenir leur identité[18] et les multiples contraintes auxquelles ils sont exposés. Dans cette section, nous essayons de mettre en exergue quelques défis rencontrés par SAKS et l’ICKL lors de leurs interventions.
SAKS et les radios communautaires face à des inquiétudes prononcées
Dans l’avant-propos de L’expérience des radios communautaires en Haïti, un ouvrage publié à l’occasion des 20 ans de SAKS, Estéus (p. 8) note que « l’institution a vécu des moments difficiles, ponctués par des pressions politiques venues de différents régimes autoritaires, par le manque de ressources financières et parfois par l’incompréhension ». Du haut de ses 32 ans de création, SAKS se débat encore au cœur des difficultés, les radios communautaires également. Jacquelin Soliman, responsable de SAKS, sans préciser la nature de ces difficultés, fait remarquer que l’institution envisage de mettre en place une activité d’économie sociale et solidaire entre les organisations créant les radios et l’administration de celles-ci. Estimant que la liberté d’action de SAKS est fondée sur son autonomie politique et financière, il appelle à une mobilisation et une utilisation efficace de « nos ressources » pour contrecarrer « nos adversaires ». Ainsi, nous nous rendons compte que les défis politiques et financiers soulignés par Estéus 12 ans plus tôt sont avérés et demeurent.
En ce qui concerne les radios communautaires elles-mêmes, les difficultés confrontées par les organisations qui les ont créées et qui les administrent affectent gravement leur fonctionnement. Aussi, ces difficultés nuisent au renouvellement de l’équipe assurant leur gestion ; ce qui, par conséquent, va à l’encontre du critère de participation au sein des radios communautaires. De plus, sur 53 radios communautaires membres du réseau de diffusion de SAKS, seulement 22 fonctionnent normalement.
Soliman résume de la manière suivante ses constats sur les radios communautaires en Haïti : dégradation de l’idéologie, non-renouvellement de l’administration, graves problèmes économiques et manque d’inventivité en termes de création des moyens de subsistance, faible pourcentage d’émissions éducatives (65% étant le niveau souhaité), lien faible avec les communautés concernées, manque d’entretien et de réparation des équipements.
En outre, les radios communautaires haïtiennes ne jouissent pas encore de reconnaissance légale. En effet, l’article 49 du Décret accordant à l’État le monopole des services de télécommunications[19] reconnait 3 catégories de radiodiffusion nationale : 1) la radiodiffusion d’État ; 2) les radiodiffusions privées (celles à caractère publicitaire et commercial, et celles à caractère culturel et religieux) ; 3) la radiodiffusion visuelle (la Télévision). Ce décret ne mentionne pas les radios communautaires. Par conséquent, elles ne sont pas protégées. Dans ce cas, elles peuvent subir à tout moment des menaces visant à les empêcher de diffuser les émissions d’analyses et autres émissions parlées. Elles pourraient être aussi considérées comme des « radios à l’essai », ne pouvant diffuser que de la musique. Cela peut conduire également à leur instrumentalisation, voire leur extinction.
En ce sens, SAKS et avec d’autres partenaires nationaux et internationaux, ont initié, en 2007, un processus d’élaboration d’un avant-projet de loi sur la radiodiffusion communautaire, visant la démocratisation de la communication dans des conditions d’égalité et sans discrimination. Ces conditions exigées vont de leur reconnaissance légale à l’octroi des fréquences radioélectriques, en passant par l’établissement de garanties en vue de leur durabilité et pérennisation.
ICKL : le renouvellement des approches et pratiques pour relever les défis
Les actions de l’ICKL sont confrontées à des défis liés à l’écosystème de l’intervention sociale en Haïti. Cet écosystème est dominé par une logique de gestion de projets souvent limités au court terme et en quête d’extrants quantifiables et palpables. Dans un tel environnement, un travail de conscientisation de longue haleine trouve très peu d’écho. Par conséquent, l’ICKL peine à trouver des partenaires financiers pour ses actions. Par ailleurs, les acquis de ses interventions sont souvent bousculés par la logique du présentéisme véhiculée par des ONG quasi omniprésentes.
Face à ces défis, l’ICKL a dû renouveler son approche de l’éducation populaire : au travail de conscientisation, il faut des initiatives économiques capables d’adresser les besoins immédiats et d’offrir un espace d’expérimentation d’un projet de société alternatif. L’économie sociale et solidaire (ESS) constitue un terrain propice à une telle approche.
Eu égard à l’ESS, l’ICKL a accompagné le processus de création et de gestion de quatre boulangeries. Trois d’entre elles n’ont pas fait long feu et l’autre baisse en termes de productivité (conséquence du blocage des routes nationales, d’abord par des contestations sociales à la fin 2018 et tout au cours de 2019, puis par la violence des bandes armées à partir de 2020). « La mobilisation territoriale pour la souveraineté alimentaire », initiée en août 2024 à Marigot (département du sud-est d’Haïti), et s’inscrivant également dans la démarche d’économie sociale et solidaire, a été conçue pour éviter les ruptures de stock provoquées dans les boulangeries par le blocage des routes nationales, entre autres. Il convient d’attendre afin de mesurer son efficacité.
Par ailleurs, l’accompagnement que l’ICKL offre à des associations paysannes partenaires, dans le cadre d’un travail de réseautage, présente un autre défi à relever[20]. En effet, la plupart des réseaux sont très peu dynamiques en dehors des interventions de l’institut. Le pari d’autonomisation de ces réseaux est loin d’être gagné. Une systématisation d’expériences réalisée entre 2018 et 2020 a apporté des enseignements révélateurs sur cette dépendance des réseaux d’associations partenaires vis-à-vis de cette institution. L’un des enseignements majeurs est le caractère exogène de la démarche de construction des réseaux. Cette construction a été encouragée par l’ICKL sur la base d’un principe universaliste, « le rassemblement des acteurs et actrices d’intérêts communs contribue à les renforcer», mais non autour d’un enjeu mobilisateur qui serait identifié dans la communauté par les membres du réseau. Tandis qu’une meilleure appropriation de la démarche de réseautage a été constatée dans les rares communautés où ce genre d’enjeux existe.
Le renouvellement des approches et pratiques étant un travail permanent, pour tenter de gagner ce pari, l’institut se propose de s’engager davantage dans la conception et l’expérimentation de dispositifs d’intervention innovants, dans la systématisation des expériences passées et en cours, bref la recherche-action. Telle est l’avenue empruntée par l’ICKL en vue de s’engager dans un renouvellement permanent de son approche de l’éducation populaire.
Conclusion
Dans cet article, nous avons exposé certains renseignements sur l’éducation populaire en Haïti (son origine et son évolution). Aussi, nous y avons fait quelques considérations sur les expériences de deux centres d’éducation populaire (SAKS et ICKL). Ces centres jouent un rôle important dans le vécu des groupes d’acteurs et des communautés touchées par leurs interventions.
Il découle que malgré les efforts effectués afin d’évoluer dans un environnement parsemé de difficultés, avec le souci constant d’améliorer leurs pratiques, les centres d’éducation populaire peinent à pérenniser des lieux d’expérimentation. À ce niveau, les différents cycles de crise politique auxquels le pays est confronté, les contraintes financières, l’écosystème de l’intervention sociale dans le pays, la culture de dépendance, l’absence de protection de la part des structures étatiques, les aléas environnementaux… ne sont pas négligeables. Ceux-ci présentent des défis majeurs quant à la viabilité des initiatives mises en place et à leur efficacité. Par conséquent, tout en préservant ce qui constitue leur identité, les centres en question doivent continuer à œuvrer dans la perspective du changement des conditions de vie des exploités et opprimés, ce qui demeure plus que jamais nécessaire en Haïti. Vu les perspectives qu’ils définissent, nous nous rendons compte qu’ils en ont conscience.
Bibliographie et webographie
Conseil Pontifical “Justice et Paix » (2004). Compendium de la doctrine sociale de l’Église. Disponible sur : http://brunoleroyeducateur-ecrivain.hautetfort.com/media/01/01/1082163843.pdf (consulté le 7 novembre 2024).
CORTEN A. (2000). Diabolisation et mal politique: Haïti: misère, religion et politique. Montréal/Paris : Les Éditions du CIDIHCA/KARTHALA.
ESTÉUS S. (dir.) [2013]. L’expérience des radios communautaires en Haïti. Port-au-Prince.
DUVALIER J.-C. (1997). Décret accordant à l’État le monopole des services de télécommunications. Disponible sur : http://www.conatel.gouv.ht/sites/default/files/loitelecom.pdf (consulté le 9 novembre 2024).
Institut culturel Karl Lévêque (ICKL) (2020). Sistematizasyon eksperyans : Demach Ranfòsman Kominotè 2013-2017.
JOINT L. A. (1996). Éducation populaire en Haïti. Rapport des « Ti Kominote Legliz et des organisations populaires. Paris : L’Harmattan.
Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS) (2006). Manyèl fòmasyon.
REYNELD S. (1998). Edikasyon popilè nan radyo kominotè. Edisyon SAKS.
[1] Les Communautés ecclésiales de base (CEB) sont des cellules mises en place au sein de l’Église catholique à la fin des années 1950 et au début des années 1960 dans le nord-est du Brésil et dans le bidonville de Miguelito de Panama (Smith Christian cité par Corten, 2000 : 65).
[2] En ce sens, il y a lieu d’actualiser les travaux de Louis Auguste Joint (1996 : 37-44) et même d’aller plus loin. Dans son livre, « Éducation populaire en Haïti : Rapport des « Ti Kominote Legliz » et des organisations populaires », l’auteur présente les conceptions d’un ensemble d’animateurs impliqués dans la dynamique de l’éducation populaire dans le pays.
[3] En français, Société d’animation et de communication sociale.
[4] « La pastorale sociale est l’expression vivante et concrète d’une Église pleinement consciente de sa mission d’évangéliser les réalités sociales, économiques, culturelles et politiques du monde ». Cette définition est tirée du Compendium de la doctrine sociale de l’Église (2004 : 145), un document rédigé à la demande du pape Jean-Paul II, par le Conseil Pontifical “Justice et Paix”. À notre avis, ce document vise à présenter une autre image de l’église catholique qui ne serait pas indifférente aux problématiques contemporaines.
[5] En français, Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif.
[6] La dictature des Duvalier a été mise en place par François Duvalier arrivé au pouvoir en 1957, et poursuivi par son fils Jean-Claude Duvalier entre 1971 et 1986.
[7] En français, Société d’animation et de communication sociale.
[8] Pour SAKS, une radio populaire porte les revendications de la classe populaire, défend ses intérêts ; elle n’est pas ouverte aux partisans de la répression, aux classes dominantes, aux bandits, aux gens et organisations qui travaillent contre l’intérêt de la populaire.
[9] La traduction française de ces critères est de nous.
[10] La traduction française est de nous.
[11] Jean-Bertrand Aristide a été président de la République d’Haïti à deux reprises : 1991-1996 et 2001-2004. Son premier mandat a été perturbé par un coup d’État entre le 29 septembre 1991 et le 15 octobre 1994.
[12] SAKS produit une émission hebdomadaire baptisée « 4 Je Kontre » (en français : Entre 4 yeux). Au cours du mois d’octobre 2024, l’institution a accompagné les radios communautaires au lancement de l’émission « Magazin Kominotè Nou Pran Lapawòl » (en français : Magazine communautaire Nous avons la parole).
[13] Voir la présentation de l’ICKL sur son site https://www.icklhaiti.org/qui-sommes-nous-2/.
[14] La liste des organisations partenaires de l’ICKL est disponible sur : https://www.icklhaiti.org/nos-partenaires/.
[15] La traduction française est déjà réalisée dans ce document.
[16] En français : Solidarité des femmes haïtiennes.
[17] La traduction française est déjà réalisée dans ce document.
[18] Renvoyant à divers sens, la notion d’identité est utilisée dans ce travail comme ce à partir de quoi l’on est différent d’autrui ou qui nous rend semblables à d’autres. Cela étant, les centres d’éducation populaire en Haïti s’attachent à favoriser un processus de conscientisation et d’organisation des masses populaires.
[19] Le décret est disponible sur : http://www.conatel.gouv.ht/sites/default/files/loitelecom.pdf.
[20] Ce défi est identifié dans un document de systématisation d’expériences publié en 2020. Ce document est disponible sur : https://www.icklhaiti.org/2022/10/03/systematisation-dexperiences-renforcement-communautaire-axe-sur-laccompagnement-des-reseaux-dorganisations/.
- Wisvel Mondélice, communicateur social, réalise des expériences professionnelles depuis plus de trois ans à l’Institut culturel Karl Lévêque (ICKL), en tant que chargé de communication et animateur. Son compte Linkedin : https://linkedin.com/in/wisvel-mondelice-111991wm. Son compte instagram : https://www.instagram.com/wisvelmondelice/. ↩︎
Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.
Pour citer cet article :
Tribune libre #13 Comment écrire l’éducation populaire en 2024 ? Les centres d’éducation populaire en Haïti : entre le maintien de l’identité et le défi de préserver des lieux d’expérimentation, Wisvel Mondélice. André Decamp, Regards sur le travail social, 9 décembre 2024. https://andredecamp.fr/2024/12/09/tribune-libre-13-comment-ecrire-leducation-populaire-en-2024/
-
Tribune libre #12 Comment écrire l’éducation populaire en 2024 ?
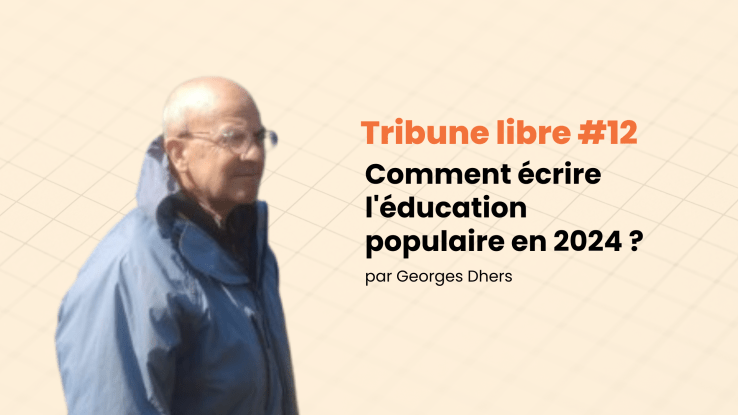
Comment les acteurs de l’éducation populaire pourraient faciliter (accélérer) la transition des acteurs de l’économie sociale et coopérative ?
Par Georges Dhers1
Nous vivons actuellement une grave période de polycrise (comme le souligne Edgar Morin : pendant ce type de période toutes les organisations qu’elles soient publiques privées ou associatives doivent revoir leur copie, faire preuve de résilience et de créativité.
Les organisations de l’économie publique, de l’économie sociale et solidaire, de l’économie coopérative, et de l’éducation populaire aussi.
Dans ce texte je voudrais proposer quelques pistes pour enrichir leur travail simultané sur les territoires en se positionnant résolument sur l’axe transition des territoires.
Ces propositions sont le fruit de réflexions qui ont émergé lors des actions que j’ai pu mener conjointement avec la fédération Léo Lagrange Sud-Ouest et l’université Toulouse Capitole entre 2021 et 2024 et qui se prolongent actuellement avec l’université populaire Edgar Morin pour la métamorphose.
Trois années donc de coopération et de co-construction qui me permettent de formuler aujourd’hui quelques réflexions et quelques propositions.
Le récit :
En 2021 Pascal Roggero professeur de sociologie à l’Université Toulouse Capitole et moi-même avons été saisis à peu près en même temps par Claudine Pepet la responsable de l’antenne Léo Lagrange qui œuvrait sur la commune de Tournefeuille pour apporter nos conseils et nos idées par rapport à l’implication de l’association dans les dynamiques territoriales et plus concrètement sur une question précise : comment mobiliser les animateurs du périscolaire dans la création de lien social intergénérationnel local.
Pascal Roggero[1] en tant que sociologue positionné sur l’approche complexe Edgar Morin[2] (dont il est un ami personnel) a de suite proposé un cadre de réflexion qui amenait les cadres de l’association à élargir la vision de leur rôle au-delà des définitions de leur métier d’animateur périscolaire pour embrasser des problématiques sociétales plus larges.
En tant qu’expert des dynamiques de développement local et formateur d’animateur dans ce champ d’action j’ai saisi l’occasion pour proposer des formations qui permettraient aux animateurs Léo de toucher aussi les parents et grands-parents des enfants quelque soient leurs métiers et catégories socioprofessionnelles.
J’avais peu de temps pour le faire puisque les animateurs Léo travaillent dans un cadre horaire très précis lié au cycle entrée et sortie des enfants de la classe de cours : les formations que je leur ai dispensées étaient donc coincées entre 9 h 30 et 11 h 30 ou bien 14 h 30 et 16 h 30 ; je prenais les animateurs par groupes de dix et les emmenais à parler de leur parcours de vie et notamment de ce que les psychologues humanistes appellent « les motivations intrinsèques » c’est-à-dire les motivations qui viennent de l’intérieur, sont spécifiques à chacun, car très liées au parcours de vie et souvent même au parcours de résilience.
Ces groupes de parole que d’un commun accord on a appelés groupes d’émergence ont permis de faire émerger en deux ou trois séances des liens fort entre les passions, compétences et projets perso ou pro des uns et des autres.
Sur la base des liens repérés les animateurs ont alors pu constituer de petits groupes projets (trois à cinq personnes) qui se mettaient vite d’accord pour travailler ensemble sur un même projet d’animation, un même objectif commun, on pourrait même dire un commun.
Faisons ici une première petite parenthèse réflexive :
Les petits groupes constituent le champ d’expérimentation le plus favorable pour simultanément développer le potentiel de chacun, créer des synergies de groupe comme l’avaient démontré les psychologues humanistes Abraham Maslow[3], Carl Rogers[4], Donald Winnicot[5]…, et faire émerger des dynamiques de créativité collective comme l’ont montré Tod Lubbart [6]et Emmanuel Mounier[7] ; Edgar Morin parle à leur sujet « d’ingénieries du micro social ».
Sans ces dynamiques de groupe, il est clair qu’au niveau local sur un territoire donné très peu d’actions d’envergure peuvent émerger et donc très peu de liens nouveaux et d’activités nouvelles peuvent être créés.
À Tournefeuille l’expérience a montré que la plupart des animateurs qui ont été formés ont pu à leur tour animer des groupes d’émergence entre eux, mais aussi avec les enfants, et souvent même avec les parents ou grands-parents ; tous ont alors pu contribuer à l’animation du territoire tout en créant de nouvelles activités utiles aux personnes, en fonction des compétences et des besoins de chacun, selon le principe d’intermédiation : ainsi a été créé un studio d’enregistrement audiovisuel qui a permis aux jeunes d’animer plusieurs quartiers de la ville ainsi que tout un ensemble d’activités culturelles (festivals de musique et de théâtre, services aux personnes, circuits courts, maraichages bio…).
Il est clair comme dit Rob Hopkins[8] que sans ces petits groupes projets qui agissent et créent du lien et des activités utiles sur un territoire c’est le chacun pour soi qui règne, le statu quo, l’isolement, et tous les risques psychosociaux qui vont avec et qui touchent toutes les classes d’âge et tous les secteurs de la population (dépressions, addictions, violences, mal être et problèmes de santé…).
Il est clair aussi que toutes ces activités de bénévolat ne sont pas répertoriées ni valorisées par les acteurs publics de l’État et des collectivités territoriales alors que ce sont elles qui maintiennent la vie sociale, l’adoucissent et la rendent plus créative : sur ce point précis on voit bien que la démarche éducation populaire rejoint la démarche économie sociale et solidaire.
De plus si on met en réseau de coopératives les activités ainsi créées sur un territoire selon les principes de l’économie coopérative et si on applique les idées proposées par le philosophe brésilien Euclide Mance[9] pour que les coopératives de consommateurs achètent aux coopératives de producteurs qui sont situées sur le territoire alors on peut postuler que ce réseau de coopératives peut finir par créer le marché local et le rendre ainsi moins dépendant des marchés financiers.
Ainsi on peut envisager que l’éducation populaire, plus économie sociale et solidaire, plus économie coopérative peuvent se rejoindre, conjuguer leurs plus-values, et constituer une démocratie créative et une économie des liens.
Revenons un instant sur ces deux concepts :
Celui de démocratie créative tout d’abord construit en 2012 par le sociologue allemand Hans Joas qui postule que les hommes ne sont pas que des homo economicus mus uniquement par le calcul d’intérêt pour eux et leur clan ; ils sont aussi capables d’agir de façon désintéressée mus uniquement par leurs motivations intrinsèques (dont les psychologues Decci et Ryan[10] ont montré la force) et par le souci de réalisation (dont Abraham Maslow a montré le caractère déterminant pour orienter une vie).
Cette vision de l’activité économique avait été aussi soutenue par le prix Nobel d’économie Amartya Sen[11] qui dans ses ouvrages sur l’éthique économique a développé le concept de « capabilités » c’est-à-dire les capacités qu’a un individu pour réaliser ce qui lui tient à cœur et le rendre utile à d’autres.
Le concept d’économie des liens fait lui référence aux travaux des sociologues comme Marcel Mauss[12] et Alain Caillé[13] qui ont théorisé l’importance du don dans les relations humaines et notamment pour en augmenter la qualité et la durabilité, alors que la relation strictement marchande l’enferme et la réduit à une relation impersonnelle, froide, et sans lendemain.
Ces concepts et les pratiques qu’ils ont inspirés de par le monde ont permis à la journaliste française Bénédicte Manier[14] d’écrire un livre intitulé « Un million de révolutions tranquilles » où elle a pu montrer comment dans le monde entier aujourd’hui des petits groupes d’individus se rassemblent, unissent leurs forces et leur idéal, et créent de toutes pièces des activités utiles pour eux-mêmes, pour leur entourage et pour la planète.
Le réseau international des Villes en transition créé par Rob Hopkins[15] est un superbe exemple de ce type d’expérimentation ; souvent les acteurs de ce réseau commencent par créer des jardins partagés ou des fermes agroécologiques puis ils organisent des circuits courts qui finissent là aussi par créer un marché local de l’alimentation, non dépendant des grandes surfaces et donc des marchés financiers.
Une constante de toutes ces expérimentations c’est la capacité à aller vers l’autre et a créer avec lui quelques alliances qui vont permettre de mutualiser les idées, les envies, mais aussi les compétences et les moyens matériels : cette mutualisation est bien sûr la clef de leur succès comme cela a été aussi la clef du succès de nos ancêtres qui à la fin du XIXe siècle ont crée les coopératives et les mutuelles.
Ne faut-il pas aujourd’hui refaire démarrer cet effort de mutualisation et de coopération économique ?
Et pourquoi ne pas le coupler avec l’effort de modernisation des organisations de l’éducation populaire ?
Ces deux champs d’action de la solidarité et de la fraternité ne doivent-ils pas aujourd’hui se soutenir de façon réciproque et faire émerger de nouvelles façons de cohabiter, de produire, et consommer de façon plus responsable ?
Les Maisons de la solidarité et de la fraternité que nous allons faire émerger sur certains territoires avec le soutien des universités populaires Edgar Morin de Grenoble, Toulouse, Montpellier sont sans doute des tentatives pour aller dans ce sens et relier ces deux grands courants de pensée et d’action du socialisme contemporain ?
Pour réussir ce challenge il est bon de revenir un peu en arrière dans ce texte sur le rôle de ceux et celles qui vont jouer un rôle d’animateur-développeur-catalyseur dans ce type de démarche et sur le rôle de ce que nous appelons dispositifs d’intermédiation créative locale (DICL).
Les DICL sont des espaces tiers (on pourrait dire aussi tiers lieux) qui permettent comme dit Annah Arendt[16] « d’organiser l’espace entre les gens » et de faire émerger entre eux des solidarités créatives.
Concrètement ces dispositifs sont basés sur les principes d’animation énoncés par Carl Rogers d’expression libre et authentique des parcours de vie, des projets, motivations, sentiments, idéaux et valeurs des uns, pendant que les autres écoutent attentivement, de façon bienveillante et sans jugement ; l’ambiance ainsi organisée et régulée par un animateur (formé au préalable) permet à chacun de faire l’expérience, rare, d’un collectif où on peut parler vrai de soi, sans craindre le jugement, ou on peut donc être reconnu pour ses spécificités, et où il est alors possible de repérer des liens interpersonnels favorables à la construction de processus d’entraide créative.
Ce processus d’entraide créative permet d’accéder à un sentiment de confiance et de cohésion qui permet alors la constitution de groupes projet orientés vers l’action sur le terrain ; la complémentarité entre les compétences individuelles permet l’émergence de compétences collectives qui, comme dit le sociologue Guy Le Boterf ;[17] augmentent le pouvoir d’agir ?
Dans l’expérimentation précitée (vécue au sein de la fédération Léo Lagrange) comme on l’a vu, c’est la formation des animateurs qui a permis de faire vivre le processus d’intermédiation créative à bien d’autres personnes (jeunes et moins jeunes) et donc de faire émerger le processus d’entraide créative, de mutualisation et de coopération.
Tout se passe donc comme si les groupes humains avaient besoin de bénéficier de la présence d’un organisateur-créateur-animateur-régulateur de processus qui engendre à la fois une sécurité, une transparence, et une confiance qui facilitent à leur tour les échanges, le partage des intériorités, et l’émergence d’une envie de faire ensemble et de créer ensemble (un peu comme dans une relation amicale ou amoureuse (Edgar Morin fait d’ailleurs souvent référence à ce type d’expériences pour montrer comment on peut sortir de la barbarie).
Dans les tiers lieux de transition que nous évoquons dans le master et le DU sur les ingénieries de transition territoriale de l’université Toulouse Capitole nous nommons ces professionnels des animateurs-développeurs-catalyseurs (ADC) car non seulement ils facilitent le repérage des liens interpersonnels et ils contribuent à les faire évoluer vers des relation de coopération, mais encore ils poussent et encouragent ceux-ci vers l’acte de cocréation d’activités utiles pour soi mais aussi pour tous sur le terrain ; encourager vers une cocréation non auto centrée mais tournée vers les autres contribue à l’émergence de nouveaux possibles pour tous.
Nous pensons que les organisations qui œuvrent dans le champ de l’éducation populaire doivent aujourd’hui former de tels ADC qui pourront à leur tour sensibiliser et former les responsables des organisations de l’économie sociale, solidaire et coopérative.
Si ce mouvement est bien encouragé, mené, et soutenu, il permettra alors peut-être l’émergence de nouvelles formes de coopérations entre les acteurs de ces secteurs et l’émergence de nouvelles formes d’économies de transition.
Ils permettront notamment de faciliter l’implication et l’empowerment d’un plus grand nombre de personnes dans le travail social de construction d’un nouveau type de société plus fraternelle, plus créative et plus résiliente, tout en permettant l’émancipation de tous ; le modèle d’organisation qu’ils vont ainsi créer pourra inspirer les autres types d’organisation (publiques et privées) et les orienter vers la métamorphose (comme indiqué dans les travaux des Universités Populaires Edgar Morin pour la Métamorphose).
[1] Pascal Roggero : Sociologue auteur de « le pouvoir des liens »
[2] Edgar Morin : sociologue et philosophe Auteur de « La méthode » et théoricien de la « pensée complexe »
[3] Abraham Maslow : psychologue qui a créé la fameuse pyramide de Maslow qui montre les niveaux de motivation
[4] Carl Rogers psychologue qui a conçu et mis au point les groupes de rencontres
[5] Donald Winnicot : psycho pediatre qui a montré les processus de développement de l’enfant
[6] Tod Lubart : psychologue qui a montré les liens entre confiance et créativité
[7] Emmanuel Mounier : philosophe qui a montré l’interaction groupe/personnes
[8] Rob Hopkins : créateur du réseau international des Villes en transition
[9] Euclide Mance : philosophe et anthropologue auteur de « La révolution des réseaux »
[10] Decci et Ryan : psychologues porteurs du courant sur les motivations intrinsèques
[11] Amartya Sen : prix Nobel indien d’économie qui a beaucoup travaillé sur l’éthique économique et théorisé le concept de capabilités
[12] Marcel Mauss : sociologue et philosophe auteur de « L’esprit du don »
[13] Alain Caille : sociologue créateur de la revue du M.A.U.S.S. et du réseau Les convivialistes
[14] Benedicte Manier : journaliste auteur « Un million de révolutions tranquilles »
[15] Rob Hopkins : créateur du réseau des Villes en transition
[16] Annah Arendt : philosophe et politologue américaine qui a beaucoup travaillé sur la modernité
[17] Guy Le Boterf : sociologue expert sur la problématique des compétences collectives
- Georges Dhers, docteur en Sciences économiques, a longtemps travaillé dans le champ du développement local (Datar, INDL…), acteur et chercheur sur les dispositifs qui facilitent simultanément le développement des personnes et des territoires, il a créé des ingénieries qui permettent l’émergence de groupes-projets de citoyens acteurs-créateurs, et conçoit actuellement des modules pour en former les animateurs. Il est membre de l’équipe de coordination du Pacte Civique. ↩︎
Du même auteur :

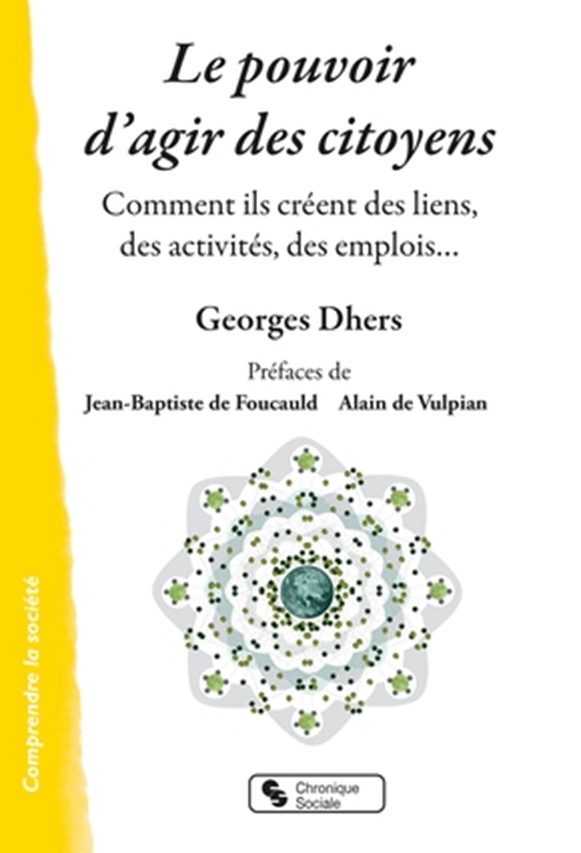
Le pouvoir d’agir des citoyens. Comment ils créent des liens, des activités, des emplois.. Par Georges Dhers. Éditeur : Chronique Sociale
Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochains par mail (“Je m’abonne” en bas à droite sur la page d’accueil). Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn.
Pour citer cet article :
Tribune libre #12 Comment écrire l’éducation populaire en 2024 ? Comment les acteurs de l’éducation populaire pourraient faciliter (accélérer) la transition des acteurs de l’économie sociale et coopérative ? Georges Dhers. André Decamp, Regards sur le travail social, 28 octobre 2024. https://andredecamp.fr/2024/10/28/tribune-libre-12-comment-ecrire-leducation-populaire-en-2024/
-
«Travail social et écologie »

Par Dominique Grandgeorge1
Cet article est une republication d’un article original de l’entretien de Dominique Grandgeorge, «Travail social et écologie.», lapenseeecologique.com [En ligne], mis en ligne le 21 Mars 2023 , consulté le 12 septembre 2024. URL : https://lapenseeecologique.com/travail-social-et-ecologie-entretien-avec-dominique-grandgeorge/
Avec l’aimable autorisation du comité de rédaction de la revue la revue électronique lapenseeecologique.com et de son Directeur de rédaction Monsieur Dominique Bourg.

LPE : Dominique Grandgeorge vous venez de publier un livre qui jette un pont entre travail social et écologie et comble ainsi un manque. Pouvez-vous vous présenter rapidement ?
DG : Initialement éducateur spécialisé, je suis aussi titulaire d’un master de sociologie de l’Université Marc Bloch de Strasbourg. Ma carrière est très diversifiée selon le type d’employeur, le statut professionnel et le secteur d’intervention (établissement privé, association d’éducation populaire, collectivité publique, école de formation) ; selon le niveau des responsabilités et les fonctions occupées (éducateur de groupe chargé de mission, directeur de l’Office public de l’habitat à loyer modéré et Centre Communal d’Action Sociale ; selon les lieux d’activités (Bourgogne Franche-Comté, Grand-Est, Suisse, Iles de la Réunion et de Nouvelle-Calédonie). Ce parcours très diversifié m’a permis de porter un regard panoramique sur le champ de l’intervention sociale dans sa globalité.
Aujourd’hui, j’interviens comme formateur en école de formation et consultant spécialisé auprès des établissements sanitaires et sociaux.
LPE : Le livre que vous venez de publier aux éditions IES s’intitule L’écologisation du travail social. Les établissements sociaux à l’épreuve du changement climatique et de l’effondrement de la biodiversité. Question brutale, pourquoi un tel ouvrage sur les établissements sociaux ?
DG : La question ne se pose pas de cette manière pour moi. Mais plutôt : pourquoi aucun ouvrage sur la question n’existait-il, ni en France, ni en Suisse ? On peut y voir une expression de l’absence de « concernement » (terme que j’emprunte au lexique suisse) et d’engagement du secteur à cette question. Pour moi, cela relève de l’inconscience, voire de l’irresponsabilité.
La question que chacune et chacun d’entre nous doit se poser c’est : « est-ce que je respecte l’écosystème ou est-ce que je le détruis ? » . Avant chaque geste éducatif, chaque activité professionnelle, chaque décision budgétaire et stratégique, je ne vois pas comment ne pas se poser la question de l’impact écologique en tant que professionnel de l’action sociale. Il est inconcevable qu’un éducateur, qu’une conseillère ou qu’une assistante sociale, à plus forte raison qu’un directeur d’établissement ne mesure pas la climat-compatibilité de son action et de son type d’accompagnement en préalable ! C’est un luxe indécent de continuer de détourner le regard. Plus on attendra, plus l’urgence deviendra ingérable et plus il nous faudra faire des choix draconiens.
LPE : Au cœur de votre ouvrage il y a le double constat de la vulnérabilité des populations déshéritées et de la vulnérabilité écologique, planétaire désormais. Pouvez-vous développer ce point s’il vous plaît ?
DG : A la vulnérabilité sociale, entendue comme le pendant individuel de l’insécurité collective sur le plan social propre aux civilisations modernes (cf. Robert Castel, 1995) se rajoute dorénavant la vulnérabilité écologique (GIEC, 2022). C’est ce que j’appelle « la double peine » affectant notre public prioritaire.
Comme l’écrit avec acuité et justesse Myriam Klinger dans la préface du livre (p.16) « la vulnérabilité se décline au pluriel et interroge aussi bien les modalités de la vie sociale que les ressources de l’environnement. Caractérisée par l’état d’instabilité et d’insécurité, induit par le ressenti de la menace d’un péril imminent, la notion de vulnérabilité recouvre d’un même mot les fragilités de l’existence sur le plan biographique et le destin incertain au niveau planétaire. (…) L’éco-anxiété et ses manifestations, auprès des plus jeunes en particulier, sont une des traductions parmi d’autres du sentiment de vulnérabilité qui arrime le sujet fragilisé à une perspective globale incertaine, voire potentiellement apocalyptique ».
Cette analyse est d’autant plus pertinente quand on sait :
1) d’une part, que le GIEC dans son dernier et 6ème rapport publié en 2021-2022, y développe pour la première fois la notion de « risque et de vulnérabilité climatique » à l’égard des populations humaines. D’après les auteurs du rapport, entre 3,3 à 3,6 milliards d’humains (sur 8) vivent actuellement dans des conditions de forte exposition au risque climatique. Parmi celles-ci, sont également concernées les populations paupérisées occidentales résidentes dans des zones particulièrement vulnérables – habitat périphérique mal aménagé, site excentré difficilement accessible , etc. -, déjà lourdement affectées par le poids des crises économiques.
2) D’autre part, que le décile supérieur de revenu mondial (les 10 % les plus riches dans le monde) consomme plus de 50 % de l’empreinte carbone. En France, les 10 % les plus aisés émettent 25 tonnes/personnes/an alors que la moyenne se situe entre 9 et 10 T/p/an et que la partie de la population la plus pauvre des Français n’émet en moyenne que 5 tonnes/an ! Comment se mobiliser en faveur d’une écologisation populaire quand on découvre que sur les 3 premiers mois de l’année 2023, un homme d’affaires français a émis 684 tonnes de CO2 en jet privé pour 56 vols sur 4 continents représentant 128 000 kilomètres. ? Quasiment l’équivalent des rejets d’un français moyen à 10T/p/an dans toute une vie ! Et quand on sait qu’ il n’est pas rare qu’un jet privé vol à vide à destination de son client aisé et fortuné qui l’attend dans l’aéroport voisin…de 30 km….. au mépris d’un quelconque souci d’ordre écologique.
Du point de vue de ces populations, et on le comprend aisément, la « double peine » est vécue comme un véritable flot de ressentiment à l’égard des catégories sociales favorisées à forte empreinte écologique, considérées comme celles qui stigmatisent les plus pauvres et leur prétendue inculture écologique. Ni plus, ni moins. Ici, les analyses centrées sur les processus de frustration relative et d’indignation morale observés par les sociologues dans les quartiers de relégation (Dubet, Lapeyronnie, 1992) retrouvent avec force leur bien-fondé.
Pourtant, à l’observation, on découvre (je pense notamment aux enquêtes de terrain de Laurence Granchamps et Romane Joli, 2023) que les habitants des quartiers populaires « expriment un attachement au vivant et à une nature ordinaire (et comestible) » en accordant une place de premier plan à de nombreuses formes « d’écologisation et de diffusion des pratiques » spontanées (jardinage, plantation et végétalisation informelles, etc.). La période du Covid a été révélatrice à cet effet.
À l’échelle des travailleurs sociaux, on l’aura compris, il est impératif qu’ils s’adaptent aux nouvelles conditions matérielles d’habitabilité. Par conséquent, il faut élargir notre point de vue de travailleur social à la lumière des enjeux écologiques et climatiques. Inclure comme vous dites (L’écologie intégrale, 2017), le social dans l’écologie et réciproquement.
Du point de vue de l’enseignement, le défi pédagogique est écrasant. Il s’agit ni plus ni moins de problématiser « comment permettre aux classes populaires de participer et de proposer leur propre vision de l’écologie ou leur propre récit de la transition écologique » (Granchamps L. & Joli, R., 2023) pour les saisir comme autant d’opportunités dans l’ enseignement délivré aux étudiant(e)s.
Dans mon livre L’écologisation du travail social. Les établissements sociaux à l’épreuve du réchauffement climatique et de l’effondrement de la biodiversité (2022), je tente de montrer comment agir concrètement de manière systémique et intégrale en faveur d’une maitrise de l’empreinte écologique générée par les activités au quotidien, en intégrant ces questions dans l’agenda du travail social.
À partir de cinq expériences pionnières et remarquables, je fais découvrir concrètement comment cette complémentarité entre question sociale et écologique dans le travail social est tout à fait jouable. A partir des données que j’ai pu recueillir (enquêtes et monographies), je propose une typologie de la qualité de l’engagement des structures. Celle-ci repose sur trois modalités et degrés d’implication et d’engagement : les petits pas, le sas de passage et l’approche globale et systémique (l’écologisation).
De cette dernière modalité – qui recouvre tout à fait ce que vous appelez l’écologie intégrale (D. Bourg & Ch. Arnsperger, 2017), à savoir engagement volontariste, projet global et action transversale -, il ressort la nécessité de réformer les contenus de formation en faveur d’un enseignement obligatoire et transversal de l’écologie comme matière incontournable, quel que soit le niveau et l’objet d’étude.
Si le travailleur social est un spécialiste de l’altérité dans toute sa dimension humaine, il est donc particulièrement préparé à l’altérité dans sa globalité. S’attacher au vivant et à la biodiversité, c’est ouvrir de nouveaux horizons qui dépassent les fonctions historiques du travail social, mobilisant collectivités territoriales, établissements publics, initiatives privées, producteurs et agriculteurs locaux, usagers et vivants non humains. Ce type de démarche va nous conduire à nous situer dans une posture plus horizontale, en acceptant parfois d’être pilote d’action et d’autre fois, de devenir simple acteur d’une autre expérience, hors champ social, élargissant de nouvelles perspectives de travail et dépassant l’entre-soi professionnel et institutionnel.
Je pense vraiment que l’écologisation peut permettre aux travailleurs sociaux de donner un nouveau sens à leur métier et ainsi contribuer à rendre le secteur bien plus attractif. En ce sens, l’écologie et la solidarité ne sont que les deux faces de la même pièce.
LPE : Qu’en est-il alors de la formation et de ses contenus ?
DG : Au regard du caractère extrêmement urgent des mutations en jeux, il me semble inévitable de concevoir les contenus de formation autour d’un socle écologique et climatique. Être à la hauteur des enjeux écologiques et par conséquent considérer les conditions d’habitabilité comme prioritaires suppose ce que j’appelle dans le livre « la réformation de l’action sociale orchestrée à l’échelle de l’ensemble du secteur dans toutes ses dimensions organisationnelles, professionnelles, éducatives, thérapeutiques » (p.13).
J’emprunte cette notion de réformation à l’historien médiéviste alsacien Francis Rapp (1995). Celui-ci propose d’élargir le regard porté sur la période de la réforme protestante. Pour cet historien, il s’agit plus d’un mouvement social de fond, d’une dynamique de transformation à l’œuvre dans la société, traversée et animée par un faisceau d’enjeux (politique, sociétal, économique, psychologique), dépassant le caractère uniquement religieux.
Aujourd’hui, l’acquisition d’une solide « culture écologique » (Charbonnier P., 2022) acclimatée aux spécificités du travail social n’est plus une option. C’est la clé de voûte de l’activité au quotidien dans le travail social. Cette culture écologique convoque les sciences de la Terre et l’ensemble des sciences sociales (anthropologie, sociologie, histoire, géographie, économique, philosophie, technologie). Aussi, les enseignements en formation de travailleur social doivent intégrer ces disciplines et ses nouveaux points de vue pour s’adapter aux nouveaux défis.
La réformation des formations consiste à envisager les enseignements de manière systémique, globale et transversale. Rajouter un « truc vert » (développement durable, responsabilité sociétale des entreprises, transition énergétique, etc.) dans une case sur la liste des indicateurs de compétences demandées ne suffira pas. C’est la totalité des parcours de métiers, l’ensemble des contenus d’enseignements qui s’appuient sur une solide culture écologique, indispensable boite à outils au travail social d’aujourd’hui. C’est ce que j’appelle « démailler le filtre vert » tout au long des parcours de formation.
Cette expression m’a été inspirée à la fois par mon expérience genevoise où j’ai puisé l’énoncé de filtre vert à la lecture d’un journal d’apprentissage d’une étudiante genevoise (Harben Tsegaï, 2021), et à la suite d’un long séjour sur l’ile de la Réunion où j’ai glané l’expression créole « démailler ».
« Démailler », c’est comme démêler quelque chose (les cheveux, la ligne de canne à pêche) inextricablement liée et mélangée ensemble sans distinctions. Démailler, c’est retrouver le fil conducteur essentiel qui réordonne les choses. « Démailler le filtre vert » d’un parcours de formation, c’est garantir l’engagement écologique et le rappel aux valeurs supérieures de la pérennité de la vie sur Terre. Si l’on en croit les conclusions de la synthèse du dernier rapport du GIEC, l’affaire n’est pas gagnée…
À mon niveau, je constate un défaut astronomique de culture écologique dans les établissements de formation. Par exemple, dans le cadre de mes enseignements, je constate que les enjeux d’adaptation aux nouvelles conditions d’existence et d’habitabilité ne concernent quasiment jamais les cadres et les directions. Or, si l’impulsion ne vient pas d’en haut et que l’ensemble du projet de l’établissement ne prend pas en compte cette question de manière globale, rien ne se passe.
Si une grande partie de la solution viendra de l’appropriation de la culture écologique, cela doit passer inévitablement par les enseignements en formation initiale, mais également continue. Adoptée en France l’été dernier, la loi Climat et Résilience s’appuie sur le comité social d’établissement (CSE) pour encourager la formation des professionnels à la transition écologique. Pourtant, les directions ne se saisissent pas de ce texte pour former leurs personnels et se former elles-mêmes au premier chef.
Les nombreuses expériences que je décris dans mon ouvrage montrent que l’inscription des établissements dans une démarche écologique repose sur l’engagement global de tous les salariés, chacun à son échelle, autour de cet objectif. Dans cette orchestration, la place du chef, du directeur et de la direction est déterminante. L’exigence écologique, que l’on doit placer au premier rang des priorités, passe inévitablement par un changement d’approche des établissements sociaux. Nous devons porter un autre regard, à la fois sur l’inscription territoriale et écologique de nos structures et sur la manière de mobiliser les équipes et les personnels dans une dynamique ouverte à l’altérité dans sa dimension de biodiversité. En ce sens, il s’agit de l’écologisation du secteur social.
LPE : On constate une sorte de résistance à cette écologisation que vous appelez de vos vœux ?
DG : Oui, c’est exact. Dans la première partie de l’ouvrage, j’essaye de comprendre – à l’aide des théories existantes -, les blocages psycho-sociaux et plus largement les raisons qui font obstacle (le déni-syndrome de l’autruche, les pulsions de survie de type neuro-cérébral héritées de notre passé millénaire, l’aveuglement idéologique au progrès technologique, source de croissance infinie et d’abondance illimitée). À cela, s’ajoute incontestablement l’amnésie environnementale générationnelle. Nous devons cette notion au psychologue américain Peter H. Kahn qui l’a théorisée en 2002.
Pour résumer, chaque génération tend à considérer comme normale la biodiversité (pourtant dégradée) qu’elle a connue dans l’enfance. Autrement dit, notre perception de l’état de la biodiversité est considérée comme normale car conditionnée par « l’environnement naturel de référence » dans lequel nous avons grandi. Si aucune fouine ne file devant mes pas à l’aube, aucun hibou ne hulule quand je rentre le soir chez moi, rien de plus normal et habituel.
Ainsi, c’est à partir de ce niveau de référence que nous mesurons les évolutions de la nature et non par rapport à celui des générations précédentes. Parallèlement au déclin des populations animales et végétales, à chaque nouvelle génération, l’état de la biodiversité est donc considéré comme à son « niveau normal de référence ». Dit autrement, l’absence de nature devient normale. Ce phénomène se reproduisant au fil des générations, la transmission du déclin des écosystèmes est impossible. Par conséquent, l’effondrement des populations et l’extinction des espèces vivantes constituent un angle mort de la transmission propre à la modernité occidentale. Ce qui a pour conséquence un « oubli de nature » qui décline de génération en génération jusqu’à se traduire comme une véritable « crise de sensibilité du vivant » comme l’exprime avec justesse le philosophe Baptiste Morizot (2018).
La pensée de Peter H Kahn va trouver un écho en France en 2017 chez Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot, auteures de l’ouvrage Le souci de la nature. Apprendre, inventer, gouverner. Dans la continuité de la pensée de l’écrivain américain, les deux auteures arrivent à la même conclusion. Moins l’humain entre en relation avec son environnement naturel, plus il en oublie l’existence. Si l’on en croit ces deux auteures, cette « amnésie environnementale générationnelle » se couplerait avec une « extinction de notre expérience de nature ». Cette dernière constituerait le facteur déterminant de l’amnésie environnementale générationnelle. Moins on est en relation avec la nature, plus on l’oublie.
Philippe Jacques Dubois, ornithologue français, fait le même constat. Auteur de La grande amnésie écologique (2012), il s’attache à comprendre comment « on finit par oublier que les territoires étaient autrefois bien plus riches en biodiversité. ». Résultat : parce que l’« amnésie tient avant tout au manque de transmission de notre mémoire environnementale », nous oublions peu à peu les éléments constitutifs du vivant qui se dégrade progressivement, accélérant ainsi sans le vouloir sa dégradation. Selon l’ornithologue, il suffit de quelques dizaines d’années pour s’accommoder de la disparation de ce qui faisait notre environnement proche, à l’exemple de l’invisibilité de la disparition des alouettes des champs ou de l’emblématique courlis cendré qui enchantait les prairies de ma jeunesse. C’est dans notre cerveau que se trouve l’explication pour Philippe J. Dubois : « À l’image d’un ordinateur, notre cerveau fait continuellement des mises à jour de notre perception du monde en écrasant la version précédente. Si l’on n’est pas très attentif au vivant et à ses évolutions, on peut très vite oublier ce à quoi il ressemblait ». Sans conteste, l’amnésie environnementale générationnelle constitue une traduction phénoménologique de la séparation entre nature et culture voulue par l’être humain occidental (les modernes) développée par Philippe Descola, Bruno Latour et vous-même.
Pour Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévôt (2017), nous sommes entrainés dans un cercle vicieux puisque « non seulement nous nous connectons de moins en moins avec la nature, parce que nos modes de vie limitent nos contacts avec elle, (…) moins nous « expérimentons » la nature, sans contrainte, librement et de façon personnelle, moins nous pensons que nos liens avec elle sont importants pour nous, et moins nous luttons pour sa préservation ». Ainsi, « si les communautés humaines ne pensent pas que la dégradation de l’environnement est importante, il n’y a pas de raison que les politiques ou les institutions s’en chargent ».
Ce sont ces processus à l’œuvre qui expliqueraient pourquoi la préservation de la biodiversité dans son ensemble n’est pas inscrite dans les priorités politiques. La « biodiversité ne se limite pas aux espaces remarquables et protégés que nous imaginons vierges de toute influence humaine. C’est aussi et surtout un tissu vivant dont nous faisons partie, une biodiversité ordinaire, agricole ou urbaine. Quand le fonctionnement de la nature est à ce point modifié, nos sociétés elles-mêmes sont en danger ».
Pour contrer ce phénomène, il faut donc multiplier les « expériences de nature » qu’elles soient éducatives, pédagogiques, collectives ou personnelles. En ce sens, l’éducation populaire à l’environnement doit être enseignée comme discipline à part entière dès la maternelle selon Philippe Jacques Dubois. Alors qu’Anne Caroline Prévôt et Cynthia Fleury nous convient à poser les jalons d’un nouveau contrat social fondé sur la réconciliation entre nature et humains.
C’est pourquoi il appartient au secteur social et d’éducation populaire de s’emparer de ces questions et de faire sa part en contribuant à son niveau à la fondation d’un pacte nouveau qui renoue les liens perdus avec l’altérité écosystémique dans toutes ses dimensions de biodiversité (vivants humains et non humains).
Car comme l’écrit avec beaucoup de sensibilité, Peter H. Kahn, « nos corps et nos esprits ont été faits pour regarder le ciel nocturne. Pour marcher sur de longues distances. Pour nager dans les rivières sauvages, cueillir des baies et croiser un bref instant le regard d’un animal sauvage et savoir que cet animal, à sa manière, vous reconnaît comme un autre être. Cela fait partie de la bienfaisante réciprocité de la nature. Cela fait magnifiquement écho, toutes choses étant égales par ailleurs, au fait de regarder dans les yeux d’un être aimé et réciproquement. Voir et être vu. Connaître et être connu. »
Mi Swing Es Tropical Quantic Nickodemus Ft Tempo The Candela Allstars
- Dominique Grandgeorge est éducateur spécialisé et détenteur d’un master en sociologie et formateur et consultant spécialisé dans la transition écologique. À partir de son expérience professionnelle en qualité d’enseignant auprès de futurs travailleurs sociaux, des scientifiques du climat et du vivant et surtout de la pensée de Bruno Latour, Dominique Grandgeorge démontre l’urgence de reformater les contenus de la formation des travailleurs sociaux. Il est l’auteur de l’ouvrage « L’écologisation du travail social ». ↩︎
-
L’espérance en mouvement : comment faire face au triste état de notre monde sans devenir fous.

» L’espérance en mouvement n’est pas un vain rêve.
L’espérance en mouvement n’attend son salut ni du justicier sur son cheval ni d’un quelconque sauveur.
L’espérance en mouvement est l’éveil à la beauté de la vie pour agir en son nom.
Nous appartenons à ce monde.
La toile de la vie nous appelle.
Nous venons de loin et sommes ici pour jouer notre rôle.
Avec l’espérance en mouvement, nous réalisons
que des aventures nous attendent,
que des forces vont se révéler, que des compagnons existent pour nous épauler.
L’espérance en mouvement, c’est être prêts à s’engager.
L’espérance en mouvement, c’est être prêts à découvrir nos forces
et celles des autres ;
Prêts à connaître les raisons d’espérer et ce que nous pouvons aimer.
C’est être prêts à découvrir combien nos coeurs sont grands, nos esprits rapides, notre détermination inébranlable ;
découvrir notre sentiment de justice, notre amour de la vie, notre curiosité intense ;
découvrir que nous possédons une patience insoupçonnée, profonde, tenace, des sens aiguisés,
et que nous sommes capables d’ouvrir le chemin.
Rien de cela ne peut être découvert dans un fauteuil, ou sans risque. » (p. 65-66)
Macy, J., & Johnstone, C. (2018). L’espérance en mouvement: comment faire face au triste état de notre monde sans devenir fous. https://lnkd.in/e_kNtErsNina Simone – Strange Fruit